PATRIMOINE HISTORIQUE
Auchel (3 kms)
Une première église existait à Auchel au XVIe siècle. En 1537, lors d’un pillage par les troupes françaises, la tour de l’église est détruite ainsi qu’une partie de l’édifice18.
Dès 1539, l’église actuelle est reconstruite dans le style gothique flamboyant, comme en témoignent la date et les armoiries de Philippe d’Olhain et de Péronne de Bonnières Souastre, seigneurs locaux, gravées sur le portail.
Selon une hypothèse historique, l’église occuperait l’emplacement d’une ancienne forteresse, et la tour de l’église serait l’une des quatre tours d’angle de cette fortification médiévale. Au fil des siècles, l’église subit de nombreux dommages liés aux guerres et aux conflits qui affectent la région du XVIe au XVIIIe siècle.
Avec l’essor de l’exploitation houillère et l’augmentation de la population au XIXe siècle, le conseil de fabrique décide en 1877 d’agrandir l’église : la nef et le chœur, alors en mauvais état, sont remplacés par une triple nef, deux chevets et deux sacristies, tout en conservant le clocher d’origine.
Pendant la Révolution, deux des trois cloches de l’église furent descendues pour être fondues en canons, mais selon la légende, elles n’auraient jamais quitté Auchel et seraient toujours cachées dans la ville.
Plus récemment, une importante campagne de restauration a été menée entre 2023 et 2024, aboutissant à l’inauguration de l’église rénovée le 11 avril 2025. Les travaux ont porté sur la réfection des façades, des toitures (dont la flèche), des vitraux et des portes, redonnant à l’édifice tout son éclat.
Donjon de Bours (5 kms)
À seulement quelques kilomètres, le donjon de Bours est une maison forte du XIVe siècle récemment restaurée, classée Monument Historique. Il représente une étape incontournable pour les passionnés de patrimoine médiéval et offre une belle occasion de découvrir l’histoire féodale de la région dans un cadre verdoyant.
Donjon de Labuissière à Bruay Labuissière (10 kms)
Dernier vestige du château de La Buissière, ce donjon du XIVe siècle est inscrit aux Monuments Historiques et offre un témoignage rare de l’architecture médiévale locale.
Château d’Olhain (16 kms)
Un château entouré de douves, considéré comme l’un des plus beaux de la région. Château fort typique des plaines de l’Europe du Nord, conservé sur ses plans d’origine, balade le long des douves après la visite.
Le château d’Olhain est un précieux exemple des châteaux forts des plaines de l’Europe du Nord. Conservé sur ses plans d’origine datant du XIIIe siècle. L’édifice est dû à Jean de Nielles, conseiller de Jean sans Peur, qui entreprit au XVe siècle des travaux de fortification. Il fut confisqué par Charles Quint, subit l’occupation des Espagnols qui firent sauter deux tours. Inscrit aux Monuments historiques en 1989, c’est l’une des plus belles forteresses médiévales de la région.
Abbaye de Belval (18 kms)
Au cœur du Ternois, dans un écrin de verdure, à 3 kilomètres de Saint-Pol-sur-Ternoise, l’abbaye de Belval est un havre de sérénité, porteur de sens et vecteur de liens, selon sa devise. Ce château érigé au XVIIIe siècle est racheté par un abbé en 1893 pour y fonder une abbaye cistercienne de sœurs trappistines, sous le patronage de saint Benoît Labre. Le site s’agrandit à partir des années 1930, les sœurs de Belval transforment la grange en fromagerie. Les fromages de Belval sont nés et désormais répertoriés par le Conservatoire des Arts Culinaires à l’inventaire du patrimoine de la région. Au départ de la communauté religieuse, en 2012, le site a été repris par une structure d’insertion par l’activité économique. Elle a permis de maintenir les différentes activités liées à l’histoire de l’abbaye : l’accueil, le ressourcement, la fromagerie et la vente de produits monastiques. Régulièrement, le site accueille des expositions culturelles.
PATRIMOINE MINIER INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 30 juin 2012, en tant que « paysage culturel évolutif vivant ». Cette reconnaissance internationale place le Bassin minier aux côtés de sites emblématiques comme les Pyramides d’Égypte, la Grande Muraille de Chine ou le Palais de Versailles.
Ce patrimoine a une valeur universelle exceptionnelle :
- Le site a été reconnu pour son authenticité, son intégrité et son importance dans l’histoire de l’industrialisation mondiale. Il symbolise aussi la condition ouvrière et l’émergence de la solidarité sociale, tout en étant un lieu emblématique de la construction européenne (CECA).
- En France, il s’agit du seul ensemble minier inscrit à ce titre, et il fait partie des rares « paysages culturels » reconnus par l’UNESCO dans le monde.
Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais est ainsi un témoin majeur de l’histoire industrielle et sociale, dont la préservation et la valorisation sont aujourd’hui reconnues à l’échelle mondiale




Pourquoi le patrimoine minier de cette région est-il considéré comme exceptionnel par l’UNESCO
Le patrimoine minier du Bassin minier du Nord-Pas de Calais, incluant la région de Camblain-Châtelain, est considéré comme exceptionnel par l’UNESCO pour plusieurs raisons majeures :
- Valeur universelle et exceptionnelle : Ce patrimoine témoigne de l’un des grands tournants de l’histoire de l’humanité : l’industrialisation. Le Bassin minier a joué un rôle fondamental en fournissant le charbon, énergie clé de cette révolution industrielle, ce qui le rend universellement significatif.
- Paysage culturel évolutif vivant : Le site est reconnu comme un « paysage culturel évolutif », où l’on peut lire dans le paysage la succession de trois siècles d’exploitation minière, avec une remarquable continuité et homogénéité. On y trouve une mosaïque de terrils, fosses, chevalements, cités ouvrières, équipements collectifs, et paysages agricoles, tous témoins de cette histoire.
- Quantité, diversité et qualité de conservation : Comparé à d’autres sites industriels mondiaux, le Bassin minier du Nord-Pas de Calais se distingue par la quantité, la diversité et l’état de conservation de ses éléments patrimoniaux. Les terrils n’ont pas tous été arasés et les cités minières ont conservé leur cohérence architecturale, offrant un ensemble lisible et unique.
- Représentativité de la mono-industrie extractive : Le bassin minier est un exemple rare de territoire quasi exclusivement dédié à l’extraction charbonnière pendant près de trois siècles, ce qui rend ses différentes strates d’exploitation particulièrement visibles et compréhensibles dans le paysage.
- Héritage humain, social et culturel : Le patrimoine comprend non seulement des infrastructures industrielles, mais aussi l’habitat ouvrier, les écoles, les églises, les équipements sociaux et culturels, reflétant l’organisation sociale et la vie communautaire autour de la mine.
- Mémoire collective et identité régionale : L’inscription consacre la mémoire de générations de mineurs et la transformation d’un territoire, marquant l’identité et la fierté de la région tout en rendant hommage à un monde disparu.
L’exceptionnalité reconnue par l’UNESCO tient à la portée universelle de l’histoire industrielle, à la richesse et à la conservation de ses paysages et architectures minières, et à la dimension humaine et sociale de ce patrimoine, qui en font un site unique au monde.
Ce qui compose ce patrimoine :
- L’inscription concerne 353 éléments représentatifs de l’histoire minière (terrils, fosses, chevalements, cités minières, cavaliers, etc.), répartis sur 109 sites couvrant environ 4 000 hectares.
- Ces éléments illustrent trois siècles d’extraction du charbon, du XVIIIe au XXe siècle, et témoignent de la transformation du paysage, de l’architecture industrielle, de l’urbanisme ouvrier et de la vie sociale liée à l’activité minière.
- Le Bassin minier est un exemple exceptionnel de mono-industrie extractive, avec une densité et une diversité remarquables de patrimoine technique et social, bien conservé et représentatif de toutes les époques de l’industrie charbonnière.
Le secteur de Camblain-Châtelain, situé au cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, regorge de témoignages du passé industriel et minier qui a façonné la région.
Lien entre le patrimoine minier près de Camblain-Châtelain et la région du Bassin minier du Nord-Pas de Calais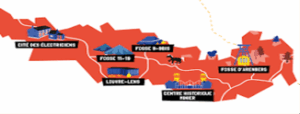
Le patrimoine minier autour de Camblain-Châtelain fait partie intégrante du Bassin minier du Nord-Pas de Calais, un territoire qui s’étend sur environ 120 kilomètres de long et 12 kilomètres de large, et qui a été profondément transformé par près de trois siècles d’exploitation charbonnière. Ce lien se manifeste à plusieurs niveaux :
Camblain-Châtelain se situe dans la zone du bassin minier, qui représente l’extrémité occidentale du grand bassin houiller européen. Les sites miniers locaux (fosses, terrils, cités ouvrières) sont des exemples typiques des transformations industrielles et sociales qui ont marqué l’ensemble du bassin.
Patrimoine technique, social et culturel : Les vestiges miniers proches de Camblain-Châtelain (comme les fosses, terrils, corons et cités minières) participent à la diversité et à la richesse du patrimoine du bassin minier. Ils illustrent l’ensemble du « système minier » : extraction, habitat ouvrier, organisation urbaine, et vie communautaire, qui sont au cœur de la valeur universelle exceptionnelle reconnue par l’UNESCO.
Le patrimoine minier de Camblain-Châtelain, comme celui du reste du bassin, témoigne de l’identité ouvrière, des migrations, des innovations techniques et des évolutions sociales qui ont marqué la région Nord-Pas de Calais. Il s’inscrit pleinement dans la mémoire collective et la valorisation contemporaine de ce territoire.
En résumé, le patrimoine minier de Camblain-Châtelain est un fragment local du vaste ensemble du Bassin minier du Nord-Pas de Calais, partageant son histoire, ses paysages, ses typologies architecturales et sa reconnaissance internationale comme patrimoine mondial de l’UNESCO
Voici une sélection des sites et éléments de patrimoine minier les plus remarquables à découvrir à proximité de Camblain-Châtelain, offrant chacun une perspective unique sur l’histoire et l’héritage des mines de charbon et de fer.
Le musée de la Mine Jacques DERAMAUX - Auchel (3 kms)
À seulement quelques kilomètres de Camblain-Châtelain, ce musée incontournable propose une immersion dans l’univers des mineurs du bassin d’Auchel. Il reconstitue fidèlement une galerie de mine et présente de nombreux objets, outils et documents d’époque. Le musée se distingue par la richesse de ses collections et l’accessibilité de ses espaces, adaptés à tous les publics. C’est le lieu idéal pour comprendre la vie quotidienne des mineurs et l’évolution des techniques d’extraction.
Les Terrils – Bruay Labuissière (8 kms)

Ce terril, vestige emblématique de l’activité charbonnière, domine le paysage de Bruay-la-Buissière. Il offre un point de vue saisissant sur la région et témoigne de l’ampleur des travaux miniers. La visite de ce site permet de saisir l’impact environnemental et paysager de l’exploitation du charbon, tout en profitant d’une balade atypique dans un décor chargé d’histoire.
La Cité des Electriciens – Bruay Labuissière (8 kms)

La Cité des Électriciens de Bruay-la-Buissière bénéficie d’une protection patrimoniale forte : elle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 2009, ce qui concerne toutes les façades et toitures des bâtiments situés dans les rues portant les noms de grands scientifiques de l’électricité (Ampère, Branly, Coulomb, Edison, Faraday, Franklin, Gramme, Laplace, Marconi et Volta)71. Cette inscription reconnaît la valeur architecturale et historique de la cité, la plus ancienne cité minière préservée du Nord de la France, construite entre 1856 et 1861 par la Compagnie des mines de Bruay pour loger les familles de mineurs de la fosse n°1.
En 2012, la cité a également été intégrée à l’inscription du Bassin minier du Nord-Pas de Calais sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, en tant que l’un des cinq grands sites emblématiques du « paysage culturel, évolutif et vivant » du bassin minier. Cette double reconnaissance (Monuments Historiques et UNESCO) garantit la préservation, la valorisation et la transmission de ce patrimoine exceptionnel, tout en permettant sa reconversion en site culturel, touristique et pédagogique
Oignies (48 kms)
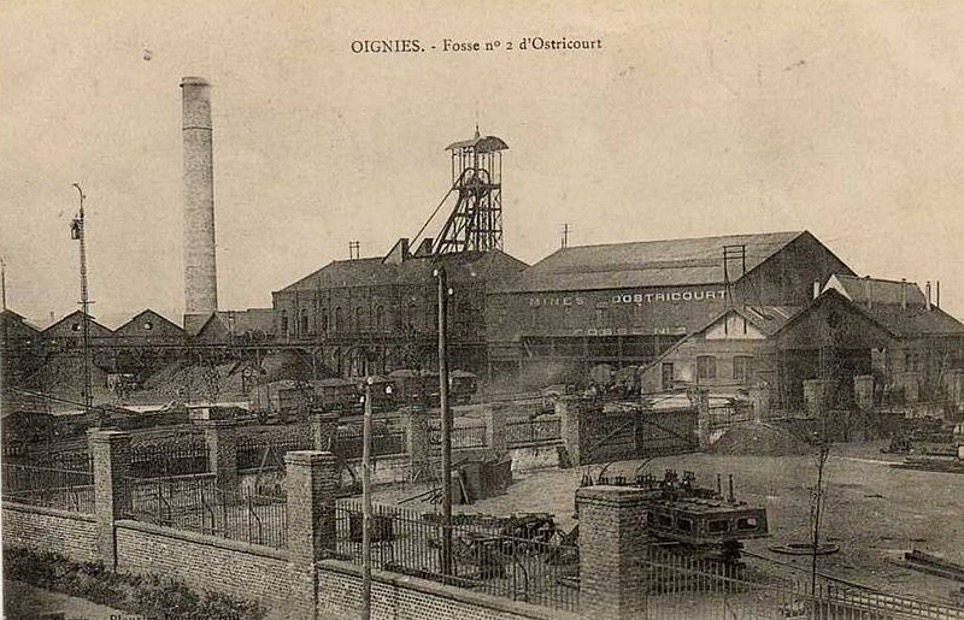

Oignies occupe une place centrale dans l’histoire minière de la région. C’est ici, en 1842, que l’ingénieur Louis-Georges Mulot découvre le charbon dans le parc du château de Madame Henriette de Clercq, marquant le début de l’exploitation charbonnière dans le Pas-de-Calais.
Oignies est un haut lieu du patrimoine minier français, à la fois point de départ et point final de l’épopée charbonnière du Nord-Pas-de-Calais. Son site 9-9bis, reconnu par l’UNESCO, est un témoin exceptionnel de l’histoire industrielle, sociale et culturelle de la région.
En 1852, la Société des Mines de Dourges est créée, lançant l’exploitation industrielle qui façonnera durablement la ville et son paysage.
Le site minier 9-9bis, dont la construction débute en 1930, devient l’un des plus importants du bassin minier. Il comprend la fosse, les chevalements, le terril 110, la cité-jardin De Clercq et de nombreux bâtiments techniques remarquablement conservés (bâtiment des machines, salles des douches dites « salles des pendus », compresseurs d’air, etc.).
La fosse 9-9bis est surtout célèbre pour avoir été le dernier site d’extraction en activité du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais : la dernière berline de charbon y est symboliquement remontée le 21 décembre 1990, clôturant 270 ans d’exploitation dans la région.
Sauvé de la destruction par l’action d’anciens mineurs et d’associations, le site 9-9bis est classé Monument Historique en 1994.
En 2012, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, avec 352 autres éléments du bassin minier, au titre de « paysage culturel évolutif vivant ».
Aujourd’hui, le 9-9bis est l’un des cinq grands sites de la mémoire minière de la région, aux côtés du 11/19 à Loos-en-Gohelle, de la fosse Delloye à Lewarde, de la fosse Wallers à Arenberg et de la Cité des Électriciens à Bruay-la-Buissière.
La Cité des Electriciens – Bruay Labuissière (8 kms)
La vallée de la Clarence, qui traverse Camblain-Châtelain et ses environs, est parsemée de cités minières, de chevalements, de corons et de terrils. Ce patrimoine bâti et paysager, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, reflète la diversité et la richesse de l’héritage minier local. La découverte de ces cités ouvrières et de leurs architectures typiques permet d’appréhender la dimension sociale et humaine de l’aventure minière.
Centre minier de Lewarde (63 kms)
Situé à Lewarde, à 8km de Douai dans le Nord, le Centre Historique Minier se trouve au coeur du bassin minier. Il est installé sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye qui regroupe 8 000 m² de bâtiments industriels, sur un site de 8ha.
Créé à l’initiative des Houillères en 1982, le Centre Historique Minier ouvre au public en 1984 avec pour mission de conserver et valoriser la culture minière du Nord-Pas de Calais, afin de témoigner auprès des générations futures des trois siècles d’activité minière.

La Trouée d’ARENBERG et la course Paris Roubaix (85 kms)
L’histoire de la mine d’Arenberg est intimement liée à l’intégration de ce secteur pavé dans la course Paris-Roubaix. C’est Jean Stablinski, ancien mineur de la fosse d’Arenberg devenu champion du monde cycliste, qui a suggéré ce tronçon aux organisateurs en 1967. Il connaissait parfaitement la Drève des Boules d’Hérin, qu’il empruntait chaque jour pour se rendre à la mine, et affirmait être « le seul coureur à être passé dessus et dessous ». Cette connexion directe avec le monde minier a donné à la Trouée d’Arenberg une aura unique et authentique.
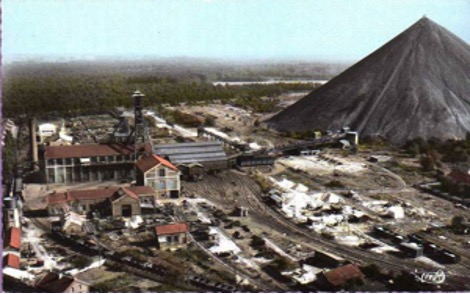

Le secteur pavé traverse une ancienne zone minière, marquée par les chevalements encore visibles et la mémoire des « gueules noires ». Les pavés eux-mêmes ont servi autrefois à transporter ouvriers et matériaux, reliant la mine au reste du territoire. Cette dimension historique fait que la traversée d’Arenberg, pour les coureurs, évoque la dureté et le danger du travail minier : « Traverser Arenberg, c’est comme descendre dans une mine de charbon : si vous pensez au danger, c’est fini ». Le parallèle entre l’effort des cyclistes et celui des mineurs renforce la dramaturgie du lieu.
La présence de la mine d’Arenberg confère à ce secteur une identité forte, à la fois sportive et patrimoniale. Les vestiges miniers (chevalements, terrils, infrastructures) rappellent le passé industriel du Nord, aujourd'hui valorisé dans le cadre du patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui rejoint directement votre intérêt pour l’histoire minière du bassin du Nord-Pas-de-Calais7. La Trouée d’Arenberg n’est pas seulement un défi sportif, c’est aussi un hommage vivant à la mémoire ouvrière de la région.
L’histoire de la mine d’Arenberg imprègne le secteur pavé de sa rudesse, de sa symbolique et de son authenticité. Elle transforme la traversée de la Trouée en un acte de mémoire, où chaque passage rappelle la sueur et le courage des mineurs, tout en magnifiant la légende de Paris-Roubaix.
LA CHAINE DES TERRILS LOOS EN GOHELLE (30 kms)
La Chaîne des Terrils désigne un ensemble remarquable de terrils, vestiges de l’activité charbonnière du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, dont les plus emblématiques sont les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, situés sur la base du 11/19, à proximité immédiate du Louvre-Lens.
Ce site est reconnu pour la richesse de son patrimoine industriel, naturel et historique.
Les terrils jumeaux, situés sur la base du 11/19, sont les plus hauts d’Europe, culminant à environ 186 à 190 mètres.

Les terrils jumeaux font partie des cinq grands sites miniers inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO, aux côtés de la Cité des Électriciens, du Centre Historique Minier de Lewarde, du 9-9bis à Oignies et du site minier de Wallers-Arenberg.
Depuis leur sommet, accessible par des sentiers balisés, ces deux « pyramides noires » offrent un panorama à 360° sur la région, permettant d’apercevoir Lille, le Mont de Cassel, le monument de Vimy, et de nombreux autres terrils.
Biodiversité remarquable : Ces terrils abritent plus de 150 espèces animales et près de 200 espèces végétales, certaines originaires d’Afrique ou d’Australie, offrant un véritable réservoir écologique.
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Chaîne des Terrils, basé à Loos-en-Gohelle, œuvre depuis 1989 à la protection, l’animation et la valorisation des terrils du bassin minier.
L’association propose des visites guidées, des randonnées, des animations pédagogiques et des sorties « Nature & Patrimoine » pour petits et grands, afin de sensibiliser à l’environnement, au patrimoine et au développement durable.
Le site du 11/19, ancien carreau de fosse reconverti, accueille également la Scène Nationale Culture Commune et propose une lecture des bâtiments industriels, des chevalements et du paysage minier.
La Chaîne des Terrils est classée parmi les sites et paysages d’intérêt par l’État français, afin de préserver la mémoire minière et la richesse naturelle de ces lieux pour les générations futures.
Ce classement vise à concilier protection, gestion et évolution du paysage, tout en favorisant le développement durable et le tourisme raisonné.
Activités : visites guidées, randonnées, animations nature, ateliers pédagogiques, observation de la faune et de la flore, découverte du patrimoine industriel et naturel.
Ouverture : toute l’année, avec des activités adaptées à tous les âges.
« Profitez de vos vacances ou d’un week-end pour passer un moment unique en famille ou entre amis en venant vous ressourcer et vous instruire au sommet des plus hauts terrils d’Europe ! »
La Chaîne des Terrils à Loos-en-Gohelle est ainsi un site incontournable pour comprendre l’histoire industrielle du Nord de la France, tout en profitant d’un espace naturel exceptionnel, aujourd’hui symbole de reconversion et de transmission du patrimoine.
Histoires et légendes autour de la reconversion des terrils
Les terrils du Nord-Pas-de-Calais, vestiges de l’ère charbonnière, sont aujourd’hui le théâtre d’une reconquête à la fois naturelle, sociale et imaginaire. Leur reconversion a donné naissance à de nombreuses histoires et légendes, mêlant mémoire ouvrière, biodiversité et récits fantastiques.
Légendes et récits populaires
- Des visites guidées et contées, comme celles proposées à Loos-en-Gohelle, mettent en scène des légendes locales où les terrils deviennent le repaire de créatures mystérieuses, de lutins ou d’âmes de mineurs. On raconte que certains soirs, les brumes qui enveloppent les sommets laissent entrevoir des silhouettes fantomatiques, gardiennes de la mémoire des gueules noires.
- D’autres récits évoquent les « feux du terril » : certains monticules, en combustion lente, dégagent encore de la chaleur et une lueur rougeâtre, alimentant l’imaginaire populaire de flammes souterraines ou de trésors cachés sous la cendre.
Histoires de reconquête et de renaissance
- La reconversion des terrils est souvent racontée comme une « reconquête naturelle » : après l’abandon de l’activité minière, la nature a repris ses droits, transformant ces montagnes noires en véritables refuges pour la faune et la flore, et en symboles de renaissance pour la région.
- Certains sites, comme Chabaud-Latour ou les terrils de Loos-en-Gohelle, sont devenus des espaces de loisirs, de promenade et de biodiversité, où l’on aime dire que « le noir est devenu vert ».
- On relate aussi l’histoire des anciens mineurs, qui, voyant les terrils devenir des lieux de vie et de détente, y retrouvent une part de leur fierté et transmettent aux nouvelles générations la mémoire du travail et de la solidarité.
Entre mythe et réalité
- La frontière entre histoire et légende est souvent ténue : les récits de reconversion sont porteurs d’espoir mais aussi de nostalgie, mêlant la dureté du passé industriel à la magie d’une nature retrouvée et à l’imaginaire collectif.
- Les terrils, jadis symboles de labeur et de souffrance, sont aujourd’hui célébrés comme des « montagnes de mémoire », où chaque sentier, chaque arbre, chaque légende racontée participe à la réinvention du territoire.
« Cette visite insolite lève le voile sur les légendes de ce lieu et les différentes créatures qui pourraient occuper aujourd’hui les souterrains et les terrils. »
En somme, la reconversion des terrils est racontée dans la région à travers des histoires de transformation, de résilience et de transmission, où la réalité de la nature renaissante se mêle aux légendes et aux récits populaires.
Activités éducatives et randonnées proposées sur les terrils de Loos-en-Gohelle



Le CPIE Chaîne des Terrils propose une large gamme d’activités éducatives et de randonnées adaptées à tous les âges et à différents publics, autour des terrils de Loos-en-Gohelle, site emblématique du patrimoine minier et naturel du Nord-Pas-de-Calais.
- Balades thématiques Art & Nature : Parcours mêlant découverte sensorielle, histoire minière, biodiversité et ateliers artistiques (peintures végétales, créations avec des éléments naturels). Adapté notamment aux jeunes enfants (6-7 ans).
- Ateliers géologie, faune et flore : Découverte pratique de la géologie des terrils, observation et identification des plantes et animaux qui peuplent ces milieux uniques. Les contenus sont adaptés selon la saison.
- Enquête policière grandeur nature : Jeu d’énigmes sur les hauteurs du terril, où les participants mènent l’enquête sur la disparition d’une libellule, tout en découvrant la faune, la flore et l’histoire du site.
- Rallye des terrils : Parcours avec épreuves d’orientation, d’observation, d’identification de la faune et de la flore, et défis sportifs, adaptés selon l’âge et le niveau des participants (notamment pour les 9-12 ans avec accompagnement adulte).
- Exploration de la biodiversité : Activités d’exploration pour rechercher et observer les petits animaux des friches, comprendre leur rôle dans l’écosystème, et ateliers sur la reconnaissance des oiseaux et la fabrication de boules de graisse en hiver.
- Découverte de la mémoire géologique : Manipulation de roches, identification de fossiles et compréhension de l’histoire géologique du bassin minier.
- Lecture de paysage : Analyse de l’évolution du paysage minier, lecture des traces laissées par l’homme et la nature au fil du temps.
Randonnées et parcours sportifs
- Ascension des terrils : Montée sportive sur les sentiers aménagés menant au sommet des plus hauts terrils d’Europe, avec vue panoramique sur la région.
- Sentiers de découverte : Parcours balisés pour découvrir la richesse écologique et patrimoniale des terrils, accessibles en autonomie ou lors de sorties guidées.
- Parcours d’orientation : Cartographie simplifiée en main, les équipes se déplacent sur les sentiers pour relever des défis d’observation et d’orientation.
- Randonnées nature : Circuits adaptés à différents niveaux, permettant de profiter de la biodiversité et des paysages uniques du site.
Pourquoi les terrils de Loos-en-Gohelle sont un symbole du développement durable local ?
Les terrils de Loos-en-Gohelle incarnent le développement durable local pour plusieurs raisons majeures, liées à la reconversion de ces sites, à leur rôle écologique et à leur valeur patrimoniale.
- Reconversion d’un héritage industriel en espace naturel et social
- Autrefois considérés comme de simples déchets de l’industrie minière, les terrils sont aujourd’hui valorisés comme des espaces naturels, culturels et récréatifs, intégrés dans des projets de développement durable qui associent mémoire, culture, biodiversité et usages contemporains.
- Leur classement au patrimoine national et mondial a permis de transformer l’image négative de ces collines artificielles en un symbole de résilience et de renaissance du territoire, conciliant protection, valorisation et nouveaux usages pour les habitants.
- Réservoirs de biodiversité et restauration écologique
- Les terrils sont devenus de véritables « condensés de nature » dans une région fortement urbanisée, abritant une biodiversité remarquable avec des espèces végétales et animales rares ou protégées, parfois absentes ailleurs dans la région.
- Leur gestion écologique (par exemple, pâturage durable, aménagement de sentiers, actions de sensibilisation) favorise la restauration des milieux naturels, la préservation de la faune et de la flore, et la création de corridors écologiques essentiels à l’échelle du territoire.
- Atouts pour l’économie locale et le tourisme durable
- Les terrils participent à la redynamisation économique du bassin minier en attirant un tourisme axé sur la nature, la mémoire et le développement durable, créant ainsi des emplois et valorisant les savoir-faire locaux.
- Des initiatives comme l’agriculture durable, les visites guidées, les activités pédagogiques et les événements culturels contribuent au développement d’une économie respectueuse de l’environnement et du patrimoine.
- Cohésion sociale et transmission de la mémoire
- Les terrils servent de lieux de rencontre, d’apprentissage et de partage, favorisant la cohésion sociale et l’ancrage des habitants dans leur histoire collective, tout en transmettant les valeurs de respect de l’environnement et de citoyenneté écologique.
- Ils sont devenus des marqueurs identitaires forts, porteurs d’une nouvelle dynamique locale tournée vers l’avenir, tout en honorant le passé minier de la région.
En résumé, les terrils de Loos-en-Gohelle sont un symbole du développement durable local car ils illustrent la capacité d’un territoire à transformer un héritage industriel en atout écologique, économique, social et culturel, tout en s’inscrivant dans une démarche de préservation et de valorisation pour les générations future.
Les terrils : symboles de résilience et de reconversion écologique à Loos-en-Gohelle
Pourquoi les terrils symbolisent-ils une renaissance écologique et culturelle ?
« Ces terrils, de simples déchets miniers à l'origine, sont devenus des symboles de la résilience du Nord et des lieux de reconversion exemplaire, mêlant écologie, culture et économie locale ».
Les terrils de Loos-en-Gohelle sont devenus un symbole fort de renaissance écologique et culturelle car ils incarnent la transformation d’un héritage industriel en ressource vivante et créative pour le territoire.
La reconversion des terrils est le fruit d’une dynamique collective impliquant élus, habitants, associations et acteurs économiques, qui ont su transformer une « dette en carbone » en ressource pour l’avenir.
Ce processus a permis de passer « du noir au vert », une formule qui résume la trajectoire de Loos-en-Gohelle et symbolise la capacité du territoire à se réinventer autour de la mémoire minière et de la préservation de la biodiversité.
Renaissance écologique
- Ces sites, autrefois considérés comme des déchets miniers, ont été réhabilités en espaces naturels riches en biodiversité, illustrant la capacité d’un territoire à restaurer ses écosystèmes, à réduire son empreinte écologique et à s’engager dans une trajectoire résiliente et inspirante.
- Leur gestion écologique (restauration de la faune et de la flore, création de corridors écologiques, valorisation des sols) s’inscrit dans une démarche de transition vers un monde décarboné et respectueux de l’environnement, répondant aux défis contemporains du développement durable.
Renaissance culturelle
- Les terrils sont devenus des lieux de mémoire, de transmission et de création artistique, où se croisent histoire ouvrière, initiatives culturelles et projets collectifs. Ils nourrissent l’imaginaire collectif et fédèrent la communauté autour de nouveaux usages, favorisant l’émergence d’une identité renouvelée et partagée.
- En accueillant des événements, des ateliers, des parcours artistiques et des actions éducatives, ces sites participent à la diffusion d’une culture de la transition, ouverte à la diversité et à l’innovation sociale.
Un modèle pour d’autres territoires
- La méthodologie de la renaissance écologique, qui vise à inspirer, fédérer et réunir autour de projets concrets, s’applique pleinement à la transformation des terrils : elle montre comment des lieux marqués par le passé peuvent devenir des laboratoires d’avenir, porteurs de solutions pour la société et l’environnement.
En résumé, les terrils symbolisent une renaissance écologique et culturelle parce qu’ils illustrent la capacité d’un territoire à se réinventer en conciliant mémoire, nature et créativité, tout en inspirant d’autres démarches de transition vers un avenir durable.
LOOS EN GOHELLE : LA VILLE DU BASSIN MINIER DEVENUE MODELE DE TRANSITION ECOLOGIQUE EN FRANCE (30 kms)
Loos-en-Gohelle, petite ville du Bassin minier du Nord, est devenue un modèle de transition écologique en France. Après 113 ans d’exploitation minière, marquée par le modèle de développement industriel puis le choc de la désindustrialisation, elle a su tourner la page du charbon pour s’engager vers un avenir fondé sur la durabilité et la participation habitante.
Aujourd’hui, elle produit de l’énergie verte, développe des logements sobres, une alimentation sans pesticides et des mobilités douces. Loos-en-Gohelle, autrefois sinistrée, est désormais une vitrine inspirante de la transition énergétique.
Un exemple concret de résilience écologique et de reconversion réussie.
À Loos-en-Gohelle, la transition écologique est en marche depuis 30 ans. Cette ancienne ville minière ne cesse de se réinventer : production d'énergie renouvelable, agriculture bio ou encore mobilités douces. Dans tous les secteurs, le citoyen est au cœur du projet, l'initiateur et le bénéficiaire d'un mode de vie plus durable. Véritable laboratoire de la diversité, la métamorphose de Loos-en-Gohelle est plus que jamais source d'inspiration.
Loos-en-Gohelle et ses 6 850 habitants ont longtemps bénéficié de l'essor de la production de charbon pour faire prospérer la ville. Mais face à la crise industrielle et environnementale, la commune située au nord de Lens fait le pari de la transformation durable en mettant à profit la population locale.
Comment Loos-en-Gohelle a-t-elle réussi sa transition écologique à partir du charbon ?
Loos-en-Gohelle est devenue un modèle de transition écologique en France et à l’international. Cette réussite s’explique par une stratégie globale, progressive et participative, articulée autour de plusieurs axes majeurs.
- Valorisation de l’héritage minier
- Plutôt que de renier son passé, la ville a intégré les traces de l’industrie charbonnière dans sa nouvelle identité : les terrils, autrefois symboles de pollution, sont devenus emblèmes de résilience et supports d’installations solaires.
- Les sites miniers ont été reconvertis en pôles d’innovation et de développement durable, comme la Base 11/19, qui accueille aujourd’hui des activités liées à l’écologie et à l’économie sociale et solidaire.
- Leadership politique et vision à long terme
- Sous l’impulsion de maires engagés, notamment Jean-François Caron, la commune a mis en place une stratégie de conduite du changement, en embarquant la population dans la transition et en fixant des objectifs ambitieux de développement durable.
- L’accent a été mis sur l’intelligence collective, la concertation citoyenne et l’innovation sociale, pour créer une dynamique locale forte et durable.
- Transition énergétique et rénovation du bâti
- Loos-en-Gohelle a massivement investi dans les énergies renouvelables, en installant des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics et sur les terrils, et en créant la société citoyenne « Mine de soleil » pour impliquer les habitants dans la production d’énergie verte.
- La ville a lancé dès 1997 une politique d’écoconstruction et de rénovation énergétique : interdiction du chauffage électrique dans les nouvelles constructions, développement de logements sociaux à haute performance thermique, et réhabilitation massive du patrimoine bâti, notamment via les programmes Villavenir, Chênelet et Loos Rehab.
- Gestion durable des ressources et biodiversité
- Des dispositifs de récupération d’eau de pluie et d’économie d’énergie ont été généralisés, réduisant la consommation électrique de la commune de 20 %.
- Une ceinture verte de 15 km et des corridors biologiques favorisent la biodiversité et limitent l’étalement urbain.
- Implication citoyenne et changement des comportements
- Les citoyens sont au cœur du projet, avec des ambassadeurs de la transition, des ateliers participatifs et des actions de sensibilisation.
- Les habitants participent aux choix alimentaires (ex : introduction du vrac dans les commerces, paniers anti-gaspi), à la gouvernance des projets énergétiques et à la vie associative.
- Résultats et reconnaissance
- Loos-en-Gohelle est aujourd’hui une référence européenne en matière de transition écologique, citée comme exemple lors de la COP21 et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
- La commune a su transformer une crise industrielle majeure en opportunité pour inventer un modèle de développement local durable, inclusif et résilient.
En résumé, la réussite de Loos-en-Gohelle tient à la combinaison d’une vision politique forte, d’une mobilisation citoyenne continue, d’investissements dans l’innovation écologique et d’une valorisation intelligente de son héritage industriel
Avec cette métamorphose à 360°, la petite ville de l'ex-bassin minier espère raconter un nouveau chapitre de son histoire et tourner la page vers l'or vert. Alimentation durable, production solaire, mobilité douce... aucun aspect de la vie quotidienne n'est laissé au hasard.
Axes de transformation
Premier axe de la transformation de la commune : l'énergie.
Sobriété énergétique
Geoffrey Mathon a grandi dans la cité n°5, l'une des plus pauvres de la ville. Maire de Loos-en-Gohelle depuis 2023, il continue une croisade engagée depuis 20 ans par la ville pour inciter les bailleurs sociaux à construire des logements toujours plus "basse-consommation".
Produire sa propre énergie
En parallèle de la sobriété, Loos-en-Gohelle fait le pari des énergies renouvelables. Il suffit de prendre un peu de hauteur pour admirer la nouvelle toiture de l'église Saint-Vaast. En 2013, elle a été recouverte de cellules photovoltaïques.
Depuis, l'idée a germé, et huit bâtiments municipaux ont été transformés en centrale solaire, des sites exemplaires qui font désormais partie d'un circuit original : le DDTour. (Il s'agit d'une visite guidée et pédagogique à destination des professionnels sur les questions du développement durable).
Les Loossois se sont engagés dans cette transition énergétique jusqu'à y investir leur épargne. "Les panneaux sont superposés à la toiture. C'est parce que le bâtiment appartient à la ville et les panneaux à la société Mine de Soleil. La mairie n'avait pas l'argent pour payer la technologie, donc il y a eu un appel aux habitants pour qu'ils deviennent actionnaires de Mine de Soleil."
Impliquer les habitants pour changer d'échelle, c'est l'idée lumineuse de la société Mine de Soleil. 130 citoyens se sont laissé embarquer dans l'aventure des panneaux solaires. L'électricité produite représente l'équivalent de 175 foyers loossois, elle est revendue à EDF. Pour pérenniser cette implication citoyenne, chaque nouveau-né de Loos-en-Gohelle reçoit une action Mine de Soleil, un investissement pour l'avenir sachant que la ville s'est engagée à devenir un territoire à énergie positive en 2050. C'est-à-dire : produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme.
Deuxième axe de la transformation de Loos-en-Gohelle : Des mobilités alternatives
Pour ce faire, la ville participe à l'extrême-défi de l'ADEME. Le principe est simple : "créer de nouvelles solutions de déplacement pour remplacer la voiture dans les déplacements du quotidien des territoires périurbains et ruraux, et la logistique en ville."
Dans la petite commune du Pas-de-Calais, cette nouvelle solution de déplacement se matérialise par un engin voituroïde mêlant vélo et voiture électrique : le Karbikes. Cesar Lazaro-Mendez, séduit par la voiturette, a accepté de la tester : il travaille à quatre kilomètres de chez lui. Avec le Karbikes, il double son temps de trajet par rapport à la voiture, mais il est convaincu par cette alternative décarbonée pour les déplacements du quotidien.
Troisieme axe de la transformation de Loos-en-Gohelle : L'agriculture bio, ensemble
Énergie, mobilité... mais aussi agriculture, à Loos-en-Gohelle, les acteurs du changement, ce sont les habitants. La ville de l'ex-bassin minier compte dix exploitants, dont quatre ont décidé de rejoindre Bioloos : une structure qui leur permet de tester le bio sur des terres mises à disposition par la ville. Pour chaque hectare mise à la disposition des agriculteurs, ils s'engagent à convertir la même surface sur leurs propres terres.
Des solutions alimentaires nouvelles
Du champ au jardin, il n'y a qu'un pas. Pour embarquer tous les cultivateurs dans la métamorphose durable, Loos-en-Gohelle peut compter sur le projet fifty/fifty, un dispositif mis en place par la ville sur le principe "gagnant-gagnant". L’idée est de soutenir et développer les initiatives des habitants pour réaliser des projets d’intérêt général.
Ce n'est donc pas un hasard si les Anges Gardins, nés dans le Calaisis, sont venus jusque dans l'Artois. L'association cultive des jardins d'insertion pour (re)mettre des personnes sur les rails de l'emploi. À Loos-en-Gohelle, ils plantent des légumes au milieu des vergers pour garder l'humidité et favoriser les pollinisateurs. Une démarche qui permet de produire une alimentation "locale", "accessible" et de "qualité pour les consommateurs" détaille Anselme de l'association.
En mettant en culture des friches, les Anges Gardins sont en train de développer un archipel nourricier dans toute l’agglomération lensoise. "Demain, très certainement, il sera extrêmement difficile de faire venir des produits de contrées lointaines", poursuit Dominique Hays. L'objectif, donc : trouver des solutions alimentaires nouvelles. Une fois par semaine, sur la place de la mairie, les Anges Gardins vendent leurs légumes
Loos-en-Gohelle, laboratoire de la transition, crée des liens entre les hommes et diffuse ses idées au-delà des frontières de la commune. À quelques kilomètres, à Méricourt, le centre social et la cantine sont alimentés pour moitié en énergie renouvelable. Bientôt, un terrain de tennis de Liévin et une salle de sport lensoise seront recouverts de panneaux photovoltaïques Mine de Soleil.
Du noir du charbon au vert de l’espoir… Loos-en-Gohelle montre le chemin.
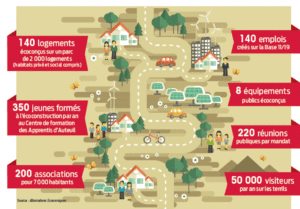
PATRIMOINE NATUREL
Le Parc CALONNIX (5 kms)
La Chaîne des Terrils désigne un ensemble remarquable de terrils, vestiges de l’activité charbonnière du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, dont les plus emblématiques sont les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, situés sur la base du 11/19, à proximité immédiate du Louvre-Lens.
Ce site est reconnu pour la richesse de son patrimoine industriel, naturel et historique.
Les terrils jumeaux, situés sur la base du 11/19, sont les plus hauts d’Europe, culminant à environ 186 à 190 mètres.
Véritable écrin de verdure, il offre une grande diversité d’activités de plein air adaptées à tous les âges :
- Sentiers de promenade le long des étangs et de la rivière, parfaits pour la détente et l’observation de la nature.
- Plusieurs parcours de pêche et deux grands étangs.
- Aires de jeux pour enfants, dont un parc de jeux en bois, des jeux gonflables, une balançoire adaptée aux personnes à mobilité réduite, une tyrolienne et des volières.
- Parcours VTT, bi-cross, skatepark, piste de roller skate.
- Courts de tennis, mur d’escalade, stand de tir, sports de raquettes.
- Centre équestre et activités d’équitation.
- Parc animalier et promenades en pédalos.
- École de cirque, paintball, course d’orientation, et organisation régulière de concerts et d’animations saisonnières (guinguettes, marchés nocturnes, fêtes, trails, Halloween, etc.).
- Restauration et buvette sur place, avec une offre de petite restauration pendant la saison estivale.
Le parc est ouvert toute l’année, avec des horaires et des animations adaptés selon la saison. Il accueille aussi bien les familles que les groupes, les sportifs ou les amateurs de nature.

Le Parc d'Olhain (13 kms), son belvédère et sa piste de luge 4 saisons
Le Parc d’Olhain est un vaste espace de loisirs et de nature situé dans le Pas-de-Calais, à proximité des communes de Fresnicourt-le-Dolmen, Maisnil-lès-Ruitz et Rebreuve-Ranchicourt. Il s’étend sur 170 hectares au cœur d’un massif forestier de 450 hectares, offrant un véritable poumon vert pour la région.


Le belvédère constitue ainsi un point de vue exceptionnel pour admirer la diversité des paysages du Pas-de-Calais et vivre une expérience à la fois contemplative et ludique au cœur du parc.

La piste de luge 4 saisons est une attraction sur rails accessible toute l’année, qui permet de dévaler une pente à plus de 35 km/h, seul ou à deux, sur un parcours de 1 000 mètres parfaitement intégré à l’environnement forestier du parc.

- Le Parc

Créé en 1973, le parc a pour mission d’offrir un espace de détente, de loisirs et de découverte accessible à tous, que ce soit pour les familles, les sportifs, les groupes scolaires ou les touristes. Il accueille plus de 500 000 visiteurs par an et propose une offre variée d’activités de plein air dans un environnement préservé.
Le Parc d’Olhain est reconnu pour la diversité de ses activités, adaptées à tous les âges et niveaux :
- Parcours de filets suspendus (plus de 3 000 m², un des plus grands au monde)
- Piste de luge 4 saisons de 1 000 mètres, sensations garanties à plus de 35 km/h
- Accrobranche, tyrolienne et belvédère culminant à 210 mètres avec vue panoramique
- Golf miniature paysagé et golf 9 trous
- Piscine de plein air ouverte en été, avec pataugeoire pour les enfants
- Parcours de VTT, randonnée pédestre, marche nordique, course d’orientation
- Village enchanté pour les enfants, avec jeux, toboggans et structures adaptées
- Hébergements variés : camping, hébergements insolites, résidences familiales, aires pour camping-cars
- Services de restauration sur place : self-service, bar-glacier, foodtruck
Le parc adhère au réseau Ethic Etapes, promouvant l’accueil, la rencontre et le brassage social et culturel. Il est également labellisé Ecolabel Européen, garantissant une gestion respectueuse de l’environnement.
- Le Belvédère
Le Belvédère du Parc d’Olhain, par sa hauteur et son emplacement, permet de profiter d’une vue panoramique exceptionnelle sur la forêt, les vallons et la campagne environnante, offrant une expérience immersive et inoubliable à ses visiteurs
Le belvédère du Parc d’Olhain est une structure emblématique située à proximité de la plaine de jeux, sur le point le plus élevé du parc. Il s’agit d’une tour unique de 40 mètres de haut, composée de 8 plateformes, qui permet aux visiteurs de culminer à 210 mètres d’altitude sur la plus haute d’entre elles.
Depuis le sommet, une vue à 360° s’ouvre sur les paysages environnants : au nord, l’ancien bassin minier et les Monts de Flandres ; au sud, l’Artois et sa campagne. Le belvédère surplombe également le Château d’Olhain et les collines de l’Artois5.
L’accès au belvédère et à ses deux toboggans (situés à 6 et 10 mètres) est gratuit.
Une table d’orientation en réalité augmentée permet de mieux identifier les différents points remarquables du panorama.
Pour redescendre, deux toboggans offrent une expérience amusante et rapide, en plus de la descente à pied.
- La piste de luge 4 saisons
Caractéristiques principales :
- Longueur du parcours : 1 000 mètres, dont 650 mètres de descente avec un dénivelé de 70 mètres.
- Vitesse : Jusqu’à plus de 35 km/h, avec la possibilité de gérer sa propre allure grâce à un système de freinage individuel.
- Parcours : Le tracé serpente entre les arbres, offrant des virages serrés, des passages en forêt et une vue imprenable sur les collines de l’Artois et le château d’Olhain.
- Sécurité : Il s’agit d’une luge sur rails, entièrement sécurisée, accessible dès 3 ans accompagné, ou en solo à partir de 10 ans et 1,35 mètre.
- Accessibilité : Ouverte à tous, la piste fonctionne toute l’année avec des horaires adaptés selon la saison.
- Expérience : Sensations fortes garanties, rires et émotions partagées en famille ou entre amis, avec la possibilité de repartir avec une photo souvenir de la descente.
La luge 4 saisons du Parc d’Olhain offre une expérience ludique et sportive, adaptée à tous les publics, dans un cadre naturel exceptionnel et sécurisé.
LOISINORD Noeux Les Mines (19 kms)
Loisinord est un complexe sportif unique situé à Nœux-les-Mines, aménagé sur un terril impressionnant de 129 mètres de hauteur, vestige de l’ère minière locale.
Ce site propose la plus grande piste de ski synthétique extérieure permanente d’Europe, d’une longueur de 320 mètres et d’une surface de 10 000 m², accessible toute l’année, aussi bien aux débutants qu’aux skieurs expérimentés, en ski ou en snowboard.
Caractéristiques principales
- Piste de ski synthétique brumisée en permanence avec de l’eau recyclée pour reproduire les sensations de la glisse sur la neige.
- Remontées mécaniques modernes : un téléski à perches débrayables et un téléski à perches fixes pour les débutants.
- Modules freestyle : half-pipe, quarter pipe, trois rampes de slide, champ de bosses, et trois tremplins pour les adeptes de sensations fortes.
- Espace débutant spécialement aménagé pour l’initiation.
- Organisation régulière d’événements : Fête du ski, Gliss’n’zik, salon de la montagne, descente du Père Noël.
Loisinord offre une expérience sportive atypique, transformant un ancien site industriel en un lieu de loisirs dynamique, avec une vue panoramique sur la chaîne des terrils et, par temps clair, jusqu’aux Monts de Flandres et la Belgique.
Le site est ouvert à tous, familles, groupes, entreprises, et attire aussi bien les amateurs de sports de glisse que ceux en quête d’une activité originale dans la région.
« Un terril transformé en montagne noire et blanche, l’expérience est belle. »
Loisinord est un exemple remarquable de reconversion industrielle, devenu un haut lieu du ski et des sports de glisse dans le nord de la France, accessible à tous et toute l’année

Marais de Mareuil (30 kms)
La fontaine Sainte-Bertille et ses promenades entre bois et marais MAROEUIL |
Maroeuil est une petite commune au cœur de l’Artois, à deux pas d’Ecoivres et du Mont-Saint-Eloi.
Une escapade dans un endroit tranquille, qui va plaire aux amoureux de promenades en plein air, aux curieux et amateurs de lieux emplis d’histoire, d’insolite et de croyances encore bien vivantes. Entre les marais aménagés en promenade, sa forêt domaniale et sa source miraculeuse de Sainte Bertille… Maroeuil mérite le détour.
Une halte à la fontaine Sainte-Bertille et son eau guérisseuse

Tous les ans, dans les jours qui entourent la fête de Sainte Bertille (11 octobre), un pèlerinage se rend de l’église, à la chapelle votive de la rue de Louez puis à la source. Les pèlerins viennent ainsi tremper un linge ou recueillir de l’eau. Eau qu’on applique ensuite sur les yeux atteints de cécité ou malades
L’espace naturel du marais de Maroeuil, une promenade le long de la Scarpe

Maroeuil, c’est également un espace naturel de 20 ha, aménagé en sentiers boisés, sur 1,7 km, qui longent les rives du Gy et de la Scarpe. Pour les amateurs de flore, on peut observer une plante rare dans notre région, le Polypode commun (Polypodium vulgare) ou encore l’iris des marais. Côté faune, vous pourrez partir à la recherche, mais sans le déranger, du minuscule escargot Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana). Gros de 3 mm seulement, il sert de mascotte au balisage du site
JARDINS ET GENS DU NORD
La fête des plantes de LOCON : une fête, un lieu de rencontres … (25 kms)
La Fête des Plantes de Locon est un événement horticole majeur dans le Pas-de-Calais, marquant le lancement de la saison des manifestations horticoles dans les Hauts-de-France.
Elle se tient sur un week-end habituellement fin mars début avril
L’idée originelle de cette Fête créée en 2003, était d’offrir aux amateurs de jardin de la région, la possibilité de découvrir un univers qu’ils ne connaissaient pas, ou, pour les plus avertis, de s’offrir LA PLANTE qui manquait à leur collection. Mais bien vite, elle devint un rendez-vous convivial, où l’on aime se retrouver, discuter entre « fous de jardin » des dernières nouveautés, questionner les exposants, admirer les stands et bien sûr où l’on craque sur les superbes plantes qui y sont proposées et ne font qu’embellir notre jardin.
Celle-ci se veut « sélective » et réunit des producteurs avant tout passionnés et qui sont sans cesse à la recherche de nouveautés… Ces plantes d’exception, les producteurs les cultivent pour la plupart eux-mêmes, dans des conditions de culture identiques à celles de nos jardins, ce qui est un gage de réussite. Ainsi, on y rencontre des producteurs de la région, mais aussi de toute la France, de la Belgique et des Pays-Bas. Ceux-ci adorent faire partager leur passion et dispenser tous les conseils souhaités pour vous donner l’envie de créer un « autre jardin »
https://www.fetedesplanteslocon.com/une-fete,-un-lieu-de-rencontres.html
Didier WILLERY : dingue de plantes (Camblain Châtelain)
Didier Willery est un jardinier passionné et conseiller botanique reconnu, surnommé le « dingue de plantes » depuis la parution de son best-seller éponyme en 2016, qui lui a valu le Grand Prix Redouté. Il possède plus de 40 ans d’expérience dans la plantation, le test et la photographie de nombreuses plantes, qu’il cultive dans son jardin personnel de 2500 m² situé à Camblain Châtelain, où il expérimente des plantations autonomes, belles et comestibles, nécessitant peu d’entretien.
Il est une figure majeure du jardinage contemporain en France, combinant expertise botanique, expérience pratique et pédagogie pour promouvoir un jardinage durable et respectueux de la nature.

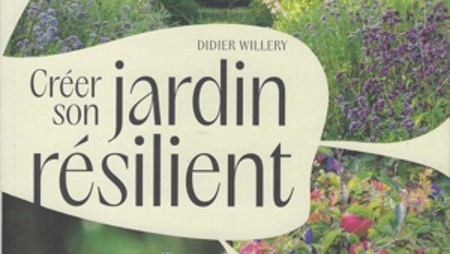
Il est également auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation et de référence sur le jardinage, publiés principalement aux Éditions Ulmer.
Ses livres, comme Créer un jardin résilient, primé en 2024, mettent l'accent sur la création de jardins naturels mais pas sauvages, favorisant la diversité végétale pour réduire les interventions comme l'arrosage, les traitements ou l'engrais.
Didier Willery est aussi un conférencier actif, partageant ses conseils pour concevoir des jardins résilients, esthétiques et productifs, qui s'adaptent aux aléas climatiques en s'inspirant des principes naturels de groupements végétaux et de la coexistence étagée des plantes. Il a travaillé comme responsable botanique du jardin privé de la Princesse Greta Sturdza, le jardin Vasterival, jusqu'en 2022
Auteur et blogueur : Didier Willery a écrit plusieurs ouvrages de référence sur le jardinage et partage régulièrement ses conseils et découvertes sur différents supports, notamment dans des magazines spécialisés tels que Détente Jardin, L’Ami des Jardins, Jardins d’Eden et Gartenpraxis.
Son Jardin Privé
Didier Willery possède également un jardin personnel, véritable laboratoire d’expérimentation où il
teste de nouvelles plantes, techniques et associations végétales. Ce jardin est réputé pour sa diversité botanique, sa résilience face aux conditions climatiques difficiles, et son approche innovante du jardinage, notamment dans la gestion de l’eau et des plantes dites “envahissantes”.
Influence et Partage
Il est régulièrement sollicité pour partager son savoir-faire lors de conférences, dans des reportages ou à travers des vidéos de visites guidées de son jardin, qui inspirent de nombreux jardiniers amateurs et professionnels.
Sa philosophie de jardinage
- Observation et imitation de la nature
Didier Willery prône une approche du jardinage qui consiste à observer la nature et à s’en inspirer pour créer des jardins résilients et autonomes.
Il privilégie l’enchevêtrement des plantes, c’est-à-dire leur mélange et leur superposition, comme cela se passe spontanément dans les milieux naturels, plutôt que de les aligner ou de les isoler artificiellement.
- Créer des communautés végétales
Selon lui, la résilience d’un jardin vient du fait que les plantes vivent en communauté : elles s’entraident, créent leur propre microclimat et se protègent mutuellement des aléas climatiques (sécheresse, excès d’eau, vent, etc.).
Il insiste sur le fait que « c’est le massif qui est résilient, pas la plante individuelle ».
- Favoriser l’autonomie des plantes
Didier Willery recommande de choisir des plantes adaptées au sol et au climat local, notamment des espèces indigènes, pour limiter les besoins en arrosage, engrais et entretien.
Il privilégie les plantes qui se ressèment spontanément, car elles sont plus robustes et mieux adaptées que celles qui sont repiquées ou trop assistées.
- Moins d’intervention, plus d’accompagnement
Le rôle du jardinier, selon lui, est d’arbitrer, d’observer et d’accompagner la nature plutôt que de la contraindre : « Le jardinier doit faire confiance à la nature et observer les événements qui se mettent en place sans lui ».
Les interventions doivent être limitées et ciblées, dans le but de préserver l’harmonie et l’élégance du jardin, sans tomber dans le « jardinage paresseux » mais en évitant l’entretien rébarbatif et inutile.
- Travailler avec la nature, pas contre elle
Il défend l’idée de coopérer avec la nature, de comprendre ses mécanismes et de s’y adapter, plutôt que de lutter contre elle, ce qui demande beaucoup d’efforts pour peu de résultats.
La philosophie de Didier Willery repose sur l’observation, l’imitation des mécanismes naturels, la diversité végétale, l’autonomie des plantes et une intervention minimale du jardinier, pour créer des jardins beaux, résilients, peu exigeants en entretien et respectueux de la nature
Comment Didier Willery définit-il la relation entre plantes et nature dans son jardinage ?
Didier Willery définit la relation entre plantes et nature dans son jardinage comme une alliance étroite et communautaire, inspirée directement des écosystèmes naturels. Il considère que les plantes ne doivent pas être isolées ou disposées de façon artificielle, mais plutôt imbriquées et associées, comme elles le sont dans la nature, où elles poussent naturellement les unes avec les autres.
Pour lui, la force du jardin réside dans la constitution de communautés végétales : chaque plante protège et est protégée par les autres, ce qui les rend collectivement plus résistantes aux aléas climatiques et aux maladies. Il affirme que « c’est le massif qui est résilient, pas la plante individuelle ». Cette organisation permet aux plantations de se développer et de se régénérer presque toutes seules, limitant ainsi les besoins en interventions humaines, en arrosage ou en traitements.
Il prône un « nouveau pacte avec la nature » : le jardinier doit observer, comprendre et imiter les mécanismes naturels, adapter ses gestes au plus près de la nature, et favoriser la diversité végétale adaptée à chaque milieu. Il résume son approche en insistant sur l’importance d’imbriquer les plantes dans l’espace et dans le temps, créant ainsi des « phytosystèmes » où la vie reprend tous ses droits et où le jardin devient un refuge aussi bien pour la biodiversité que pour le jardinier.
Quelles sont les principales techniques de Didier Willery pour favoriser la résilience des jardins ?
- Associations végétales inspirées de la nature
Didier WILLERY recommande de créer des alliances de plantes, appelées parfois « phynergies » ou « phytosystèmes », en s’inspirant des communautés végétales naturelles où les plantes s’entraident et se protègent mutuellement.
Il déconseille la ségrégation par espèces (ex : tous les fruitiers ensemble, toutes les roses ensemble) et préfère le mélange et l’imbrication des végétaux dans l’espace et dans le temps.
- Choix de plantes adaptées
Il privilégie la sélection de végétaux adaptés au sol, au climat local et aux microclimats du jardin, pour limiter les besoins en arrosage, en engrais et en soins.
Les plantes choisies doivent pouvoir se développer et se régénérer presque seules, ce qui accroît leur robustesse face aux aléas climatiques et aux parasites.
- Observation et analyse du terrain
Il insiste également sur l’importance de bien connaître son jardin : analyser le sol, comprendre les microclimats, observer la manière dont les plantes poussent naturellement, et transposer ces observations à son propre espace.
- Adaptation des gestes et techniques
Il revisite les gestes du jardinier (planter, tuteurer, arroser, tailler) pour les adapter au plus près de la nature, optimisant ainsi la reprise, la croissance et la résistance des végétaux.
Ces pratiques limitent les interventions lourdes, réduisent la consommation d’eau et évitent la dégradation des sols et la pollution.
- Diversification et complémentarité
Didier Willery encourage à diversifier la palette végétale, à combiner ornementales et comestibles, et à multiplier les types d’associations pour renforcer la résilience globale du jardin.
- Création d’un jardin-cocon
L’objectif est de créer un jardin-cocon, refuge pour la biodiversité et le jardinier, qui reste attrayant, productif et facile à vivre toute l’année, même en cas d’aléas climatiques.
Quels conseils pratiques Didier Willery donne-t-il pour associer les plantes ?
- S’inspirer de la nature et miser sur la diversité
Associer des plantes de formes, de couleurs et de textures variées pour créer un jardin dense, esthétique et résilient toute l’année.
Diversifier les plantations en mêlant vivaces, bulbes, couvre-sol, arbustes, arbres et grimpantes, à l’image des sept strates du modèle forestier naturel.
- Ne jamais laisser le sol nu
Couvrir le sol en permanence avec des plantes couvre-sol, des feuilles mortes, de la paille ou du foin pour protéger la vie du sol, limiter l’évaporation et réduire le désherbage.
- Associer comestibles et ornementales
Mélanger plantes comestibles et plantes d’ornement pour profiter à la fois de la beauté et de la productivité du jardin, tout en favorisant la biodiversité.
- Adapter le choix des plantes au sol et au climat
Sélectionner des plantes adaptées à la nature du sol et au climat local, plutôt que de vouloir imposer des espèces inadaptées.
- Planter au bon moment
Observer le rythme du jardin et planter en fonction des périodes de végétation réelles (8 « saisons » au lieu des 4 traditionnelles), pour un meilleur enracinement et une reprise optimale.
- Privilégier les associations durables
Favoriser les plantes qui se naturalisent et se ressèment seules (ex : bulbes botaniques, hellébores, perce-neige), pour limiter les interventions et obtenir des massifs qui évoluent et se renouvellent d’eux-mêmes.
- Observer et ajuster
Observer les comportements des plantes et leur sociabilité pour ajuster les associations au fil des saisons et des années, en comblant les vides ou en remplaçant les plantes qui ne se plaisent pas
En résumé, Didier Willery conseille de créer des associations riches, denses et naturelles, en s’appuyant sur la diversité, l’observation, l’adaptation au milieu, et la complémentarité entre plantes, pour obtenir un jardin beau, productif et facile à vivre toute l’année
Comment choisir les bonnes plantes pour une association harmonieuse ?
Pour choisir les bonnes plantes et réussir une association harmonieuse, il est essentiel de suivre plusieurs principes clés :
- Tenir compte des besoins similaires: Associez des plantes qui partagent les mêmes exigences en matière d’ensoleillement, de nature de sol et d’arrosage. Cela évite que certaines souffrent pendant que d’autres prospèrent, et garantit une croissance saine à l’ensemble du massif.
- Varier les formes, hauteurs et textures: Mélangez plantes basses, moyennes et hautes, ainsi que différentes textures de feuillage et de fleurs, pour créer du relief et de la dynamique visuelle. Placez les plantes les plus basses à l’avant, les plus hautes à l’arrière ou au centre selon la configuration.
- Éviter la concurrence des racines: Associez des plantes ayant des systèmes racinaires complémentaires (par exemple, des racines superficielles avec des racines profondes) pour qu’elles exploitent différentes couches du sol sans se faire concurrence, optimisant ainsi l’espace et les ressources.
- Privilégier la diversité et le compagnonnage: Intégrez des fleurs, des aromatiques et des légumes pour attirer pollinisateurs et auxiliaires, repousser les parasites et enrichir la biodiversité. Par exemple, le basilic avec la tomate, ou la lavande pour éloigner les pucerons.
- Choisir une plante dominante: Sélectionnez une essence de base ou une plante structurante qui servira de point d’ancrage visuel, autour de laquelle viendront s’articuler les autres espèces.
- Harmoniser les couleurs: Pensez à associer des couleurs qui se complètent ou créent de beaux contrastes, en ajoutant éventuellement du feuillage blanc ou argenté pour adoucir l’ensemble.
En quoi la densité et la diversité favorisent-elles un jardin équilibré
La densité et la diversité dans un jardin sont essentielles pour créer un écosystème équilibré et résilient.
- Densité : Un jardin dense, où les plantes couvrent bien le sol et occupent toutes les strates (du couvre-sol aux arbres), limite l’espace disponible pour les mauvaises herbes, réduit l’évaporation de l’eau et protège le sol. Cette densification favorise aussi la présence de haies et de refuges, ce qui attire et maintient une faune variée, renforçant ainsi la biodiversité.
- Diversité: Plus un jardin accueille de variétés de plantes (arbres, arbustes, vivaces, annuelles, indigènes…), plus il attire une grande diversité de pollinisateurs, d’insectes auxiliaires, d’oiseaux et de petits mammifères.
Cette diversité permet de :
- Favoriser la pollinisation naturelle et de meilleures récoltes,
- Réguler les nuisibles par la présence de prédateurs naturels,
- Améliorer la santé du sol grâce à l’action de différents micro-organismes,
- Accroître la résilience du jardin face aux maladies, aux parasites et aux aléas climatiques, car toutes les plantes ne réagissent pas de la même façon aux perturbations.
En combinant densité et diversité, le jardin devient un véritable écosystème vivant, capable de s’autoréguler, de limiter les interventions humaines et de rester productif et beau toute l’année
Mela Rosa : Premier créateur de roses au Nord de Paris - Grigny (40 kms)


Jean-Lin LEBRUN, en créant en 2003, la pépinière MELA ROSA, s’est imposé comme une référence dans la création des rosiers et des variétés fruitières anciennes.
Le nom de la pépinière, alliant « Mela » et « Rosa », reflète cette double passion.
Chaque année, elle ouvre ses portes au public lors d’un week-end de juin, offrant une immersion dans cet univers floral unique.
La Pépinière Mela Rosa est un espace de découverte, de création et de partage autour de la rose et du jardin, animé par la passion et l’expertise de ses fondateur
Mela Rosa 105 Rue du Bois-Tahon (62 140) Grigny
Pépinière HENNEBELLE – Boubers sur Canche (30 kms)


La Pépinière Jean-Pierre Hennebelle, située à Boubers-sur-Canche dans le Pas-de-Calais, est une référence incontournable pour les amateurs d’arbres et d’arbustes rares ou de collection. Fondée au début des années 1960 par Jean-Pierre Hennebelle, elle se distingue par son approche novatrice : un arboretum paysager de trois hectares servant d’écrin aux végétaux produits et proposés à la vente. La pépinière est reconnue pour la diversité, la qualité et l’originalité de ses collections, notamment de bouleaux (Betula) et d’érables (Acer).
La princesse Greta Sturdza, créatrice du Jardin Le Vasterival, considérait Jean-Pierre Hennebelle comme « l’un des plus grands pépiniéristes » qu’elle ait eu la chance de rencontrer, soulignant le lien fort entre la pépinière et le célèbre jardin normand.
Après le décès de Jean-Pierre Hennebelle en 2002, ses fils Nicolas et Jean-Loup ont repris la gestion de la pépinière, perpétuant la vision et la philosophie de leur père tout en enrichissant les collections existantes.
La pépinière propose un vaste choix d’arbres et d’arbustes remarquables pour leur floraison, leur feuillage, leur écorce ou leurs fruits décoratifs. Parmi les variétés d’exception créées sur place, on peut citer le pommier à fleurs ‘Comtesse de Paris’.
L’influence de l’histoire de Jean-Pierre Hennebelle sur la sélection de plantes
L’histoire de Jean-Pierre Hennebelle marque profondément la sélection de plantes proposée à la pépinière de Boubers-sur-Canche. Dès sa création dans les années 1960, Jean-Pierre Hennebelle a conçu une pépinière-jardin unique, en perpétuel changement, où la diversité, la poésie et l’expérimentation sont centrales. Il a toujours privilégié la culture en pleine terre, refusant les conteneurs et toute forme de culture artificielle, afin de garantir la vigueur et la reprise des plantes, et de préserver leur caractère naturel.
Son approche se traduit par :
- Une sélection de plus de 6000 espèces et variétés, souvent rares ou inédites, cultivées sans produits chimiques, dans une terre argileuse enrichie naturellement.
- Un accent mis sur les arbres et arbustes à écorces, feuillages, floraisons ou fruits décoratifs remarquables, avec une attention particulière à la diversité des formes et des couleurs, inspirée par la nature elle-même.
- L’introduction et la création de variétés originales, comme le pommier à fleurs ‘Comtesse de Paris’ ou la Pulmonaria ‘Majesté’, issues de ses propres sélections et semis.
Jean-Pierre Hennebelle a également innové dans la présentation des plantes, organisant la pépinière comme un grand jardin paysager, où les végétaux sont regroupés par thèmes (saisons, parfums, feuillages, écorces), offrant ainsi aux visiteurs une expérience immersive et inspirante.
Après son décès en 2002, ses fils Nicolas et Jean-Loup ont poursuivi cette philosophie, maintenant les méthodes de culture traditionnelles et enrichissant les collections emblématiques de bouleaux (Betula) et d’érables (Acer). Ils perpétuent l’esprit d’innovation, de diversité et de respect du vivant qui caractérisait leur père.
La pépinière Jean Pierre HENNEBLLE et le jardin le Vasterival


Le Jardin Le Vasterival, situé à Sainte-Marguerite-sur-Mer en Normandie, est un jardin privé de renommée internationale, créé et façonné par la princesse Greta Sturdza à partir de 1957. S’étendant sur environ 12 hectares, il rassemble plus de 8 000 à 10 000 espèces et variétés de plantes, dont d’importantes collections de magnolias, rhododendrons, hortensias, érables japonais, hellébores, et bien d’autres. Le jardin est réputé pour ses mises en scène naturalistes, sa diversité botanique et ses techniques de taille de transparence, qui sont transmises lors des visites guidées.
Un lien historique et professionnel unit la pépinière Hennebelle et le Jardin Le Vasterival. La princesse Greta Sturdza a collaboré avec Jean-Pierre Hennebelle pour enrichir son jardin de végétaux rares et exceptionnels, saluant son expertise et sa passion. La pépinière Hennebelle a ainsi contribué à la diversité botanique du Vasterival, et continue d’entretenir ce lien à travers des échanges, des visites et des conseils horticoles, perpétuant une tradition d’excellence et d’innovation dans le monde des jardins d’exception.
Les variétés rares ou oubliées que Jean Loup et Nicolas Hennebelle mettent en avant


Jean-Loup et Nicolas Hennebelle perpétuent la tradition familiale de la pépinière en mettant particulièrement l’accent sur les arbres et arbustes rares ou oubliés.
La pépinière propose environ 6 000 espèces et variétés, dont de nombreux arbres, arbustes, conifères, grimpantes, vivaces, annuelles et bisannuelles, cultivés en pleine terre selon la tradition familiale.
Parmi les variétés rares ou oubliées, on trouve des introductions originales et des plantes peu courantes, souvent choisies pour leur feuillage, leur floraison, leur parfum, leur écorce ou leurs fruits décoratifs.
Un exemple emblématique est le pommier à fleurs ‘Comtesse de Paris’, une création de la famille, qui illustre leur engagement pour la diversité végétale et l’innovation horticole.
La pépinière met en scène ses collections dans un arboretum, permettant aux visiteurs d’admirer, au fil des saisons, des arbustes remarquables pour leurs caractéristiques esthétiques et botaniques.
Parmi les arbres et arbustes mis en avant, on peut citer des essences comme l’Ulmus parvifolia ‘Geisha’, reconnu pour son feuillage et son écorce spectaculaire, ainsi que de nombreuses autres « premières introductions » en France ou en Europe.

Pépinière « Les Vivaces De Sandrine Et Thierry Delabroye » à Hantay (40 kms)
Thierry Delabroye est un pépiniériste français reconnu, spécialisé dans la culture et l’hybridation de plantes vivaces, notamment les hellébores, les heuchères et les épimediums. Avec son épouse Sandrine, il dirige la pépinière « Les Vivaces de Sandrine et Thierry Delabroye » à Hantay, dans le Nord de la France, depuis 1984.
Il s’impose comme une figure majeure de l’horticulture française contemporaine, alliant passion, innovation et exigence dans l’hybridation et la culture des plantes vivaces.


- Un Savoir-Faire Unique
Thierry Delabroye est avant tout un passionné de nature et de plantes vivaces, qu’il cultive pour leur capacité à résister aux climats froids et humides du Nord, mais aussi pour leur intérêt ornemental tout au long de l’année.
Il s’est fait connaître pour ses créations originales, notamment dans le domaine des hellébores, où il pratique l’hybridation à la main pour obtenir de nouveaux coloris et formes. Il vise, par exemple, à créer une hellébore parfumée, un objectif rare dans ce genre botanique.
Parmi ses obtentions les plus célèbres figurent les heuchères ‘Caramel’ et ‘Citronelle’, vendues dans le monde entier pour leur feuillage décoratif et leur robustesse.
- La Pépinière de Hantay
La pépinière Delabroye propose une large gamme de vivaces adaptées à tous les jardins et met l’accent sur les plantes « belles toute l’année », privilégiant le feuillage persistant ou coloré, en plus de la floraison.
L’approche artisanale de Sandrine et Thierry DELABROYE et leur accueil chaleureux sont salués par les amateurs comme par les professionnels du monde horticole.
- HELLEBORES et HEUCHERES : Reconnaissance et Influence
Thierry Delabroye est reconnu internationalement, notamment pour ses hybrides d’Heuchera villosa, cultivés et commercialisés par des pépinières à l’étranger.
Il est régulièrement présent lors d’événements horticoles majeurs, comme les Journées des Plantes de Chantilly.
Les hellébores de Thierry Delabroye se reconnaissent par leur diversité de formes (simples, doubles, anémones), leur large palette de couleurs (jaune, pourpre, noir, ardoise, etc.), leurs motifs (picotés, tachetés, veinés) et des innovations comme la ‘jaune à points rouges’ ou les doubles picotée.



En plus de l’heuchera ‘Caramel’, Thierry Delabroye a créé et développé plusieurs autres variétés hybrides remarquables, principalement dans le genre Heuchera, mais aussi dans d’autres vivaces.
Heuchera (Heuchères):
- ‘Mega Caramel’ : Version XXL de ‘Caramel’, avec des feuilles encore plus grandes et une vigueur accrue.
- ‘Kassandra’ : Issue du croisement entre ‘Caramel’ et ‘Mocha’, cette heuchère se distingue par son feuillage persistant, évoluant du doré à l’orange rosé, puis au rouge vin selon les saisons.
- ‘Citronelle’ : Mutation spontanée de ‘Caramel’, sélectionnée et commercialisée par Thierry Delabroye, célèbre pour son feuillage jaune lumineux qui préfère l’ombre.
- ‘Guacamole’ : Nouvelle variété aux feuilles jaunes au printemps, virant au vert-jaune en été, appréciée pour sa capacité à s’associer avec de nombreuses fleurs et graminées.
- ‘Pretty Perrine’ : Heuchère au feuillage bicolore vert bordé de rose carmin, avec de grandes fleurs blanches bordées de rose carmin, floraison longue et remarquable6.
Autres créations et séries en préparation :
Thierry Delabroye travaille également sur une série d’heuchères baptisée « Peintres français » avec des variétés comme ‘Van Gogh’, ‘Gauguin’, et ‘Picasso’, qui promettent des feuillages et floraisons innovants.
Les heuchères de Delabroye sont reconnues pour leur feuillage décoratif, leur rusticité et leur capacité à évoluer en couleur au fil des saisons.
Il privilégie l’hybridation à partir d’Heuchera villosa, une espèce très résistante, pour obtenir des variétés adaptées au climat du nord de la France et appréciées à l’international (notamment dans les parcs américains).
https://www.les-vivaces-de-sandrine-et-thierry.fr/
Les Jardins de Séricourt - « Jardin Remarquable » Séricourt (30 kms)
Les Jardins de Séricourt sont un lieu de promenade et de découverte unique, mêlant art paysager, histoire et nature, à ne pas manquer dans la région Hauts-de-France.
Les Jardins de Séricourt ont reçu plusieurs distinctions, dont le prix du meilleur parc de France en 2005 et celui de plus beau jardin de l’année en 2012, décerné par l’association des journalistes des jardins et de l’horticulture.
Il s’impose comme une figure majeure de l’horticulture française contemporaine, alliant passion, innovation et exigence dans l’hybridation et la culture des plantes vivaces.


Les Jardins de Séricourt sont un ensemble de jardins contemporains remarquables situés à Séricourt, dans le Pas-de-Calais, au cœur des vallées verdoyantes du Ternois.
Créés à partir de 1985 par le paysagiste Yves Gosse de Gorre, ils s'étendent sur environ 4,5 hectares et sont labellisés « Jardin Remarquable » depuis 2004.
Ces jardins se distinguent par une grande diversité d'espaces thématiques, appelés « chambres » ou « jardins », qui offrent des ambiances variées et poétiques. Parmi les plus célèbres figurent la cathédrale de roses, le jardin guerrier, le jardin des topiaires, le jardin géométrique, la chambre jaune, et un labyrinthe éphémère.
Les Jardins de Séricourt sont conçus pour susciter surprise, émerveillement et poésie, avec des allées sinueuses, des buis taillés avec humour, et une intégration harmonieuse avec la forêt environnante.
- Principales attractions à découvrir aux Jardins de Séricourt
Les Jardins de Séricourt offrent un parcours unique à travers une succession de scènes végétales et artistiques, réparties sur 4,5 hectares :
- La cathédrale de roses: Un espace emblématique où les roses sont mises en scène de façon spectaculaire, formant une véritable « cathédrale » végétale.
- Le jardin guerrier: Un jardin thématique inspiré par l’histoire des champs de bataille du nord de la France, avec des sculptures végétales évoquant les masques guerriers et des allusions à Agincourt, Crécy et aux deux guerres mondiales. Il est un hommage aux champs de bataille de la Première Guerre mondiale avec des plantations symboliques et des sculptures inspirées des statues de l'île de Pâques.
- Le jardin des topiaires: Un espace où l’humour et la créativité s’expriment à travers des buis taillés de façon originale et surprenante.
- Le labyrinthe fantastique et éphémère: Un dédale végétal qui change au fil des saisons, invitant à l’exploration et à la découverte.
- L’allée de la mer: Une promenade évoquant l’univers marin, avec une ambiance singulière et poétique.
- Le jardin géométrique: Un espace structuré, contrastant avec d’autres parties plus sauvages et ombragées du jardin.
- La chambre jaune: Un « jardin-chambre » aux couleurs éclatantes, conçu pour surprendre et émerveiller.
- Le belvédère et le ruban de briques: Des points de vue et des éléments architecturaux intégrés au paysage pour enrichir l’expérience de visite.
- La procession: Une allée sculpturale qui évoque, selon l’imaginaire de chacun, des processions de nonnes ou de chevaliers, symbolisant un chemin vers la paix.
Autres points d’intérêt :
- Des massifs de vivaces, des étangs, des allées ombragées, et des scènes végétales qui se succèdent sans symétrie, créant une atmosphère poétique et pleine de surprises.
- Une pépinière sur place pour les amateurs de plantes et de jardinage.
La diversité des ambiances, la richesse botanique et la créativité artistique font des Jardins de Séricourt un lieu incontournable pour les passionnés de jardins, d’histoire et d’art paysager.
Le jardin est ouvert en saison, généralement de mai à octobre, avec des horaires variables selon les mois, et il est accessible aux personnes à mobilité réduite sous certaines conditions.
LE JARDIN DES LIANES à Chériennes (46 kms)

Réputé pour sa collection exceptionnelle de roses anciennes, d’hydrangéas et son ambiance romantique et champêtre, ce jardin de collections labellisé propose une balade colorée et parfumée, idéale pour les amateurs de plantes rares et de jardins d’atmosphère.
Labellisé « Jardin remarquable », ce jardin de 5400 m2 se veut libre, romantique, parfumé, coloré et facile d’entretien.
Il est structuré à partir d’arbres et arbustes de collection, qui offrent une grande diversité de feuillages, assurant de la couleur du printemps jusqu’aux magnifiques couleurs d’automne.
Aux parfums des viburnums et autres arbustes à fleurs succèdent ceux de 450 variétés de roses anciennes ou anglaises que l’on peut apprécier au détour de nombreuses petites allées.
Une très belle collection d’hydrangéas (environ 500 variétés) vient aussi varier les plaisirs, offrant avec les vivaces des fleurs à admirer jusqu’aux gelées.
Un pigeonnier, un petit puit, quelques cabanes, de nombreuses gloriettes et bancs participent à son décor.
Le charme de ce jardin aujourd’hui mature tient autant dans ses allures romantiques que dans la richesse de ses plantations.
Le Jardin des Lianes se distingue par son style libre, romantique, champêtre, très coloré et facile d’entretien. Créé à partir de 1986 par Eliane et Guy Lebel, le jardin a été conçu, dessiné et réalisé par ses propriétaires, qui l’améliorent sans cesse depuis près de quarante ans.
Le jardin est structuré autour d’arbres et d’arbustes sélectionnés pour leur feuillage, leur parfum ou leurs couleurs automnales, offrant une grande diversité de végétation du printemps à l’automne. On y trouve notamment plus de 400 à 450 variétés de roses anciennes ou anglaises, ainsi qu’une impressionnante collection d’hydrangeas (jusqu’à 500 variétés selon les sources), assurant une floraison spectaculaire jusqu’aux premières gelées. Le jardin abrite aussi de nombreux arbres et arbustes rares, souvent issus de collections anglaises.
L’ambiance du jardin est enrichie par des éléments de décoration comme un pigeonnier, un petit puits, des cabanes, des gloriettes et de nombreux bancs, qui invitent à la flânerie et au repos. Le jardin est particulièrement apprécié des familles, grâce à ses allées sinueuses, ses maisonnettes pour enfants et son atmosphère chaleureuse.
Le Jardin des Lianes a été sélectionné pour représenter la région Nord-Pas-de-Calais dans l’émission « Le Jardin préféré des Français » sur France 2 en 2014.
Quels éléments romantiques et champêtres rendent ce jardin unique
Le Jardin des Lianes, par son style romantique et champêtre, offre une expérience unique grâce à plusieurs éléments soigneusement choisis et intégrés dans son aménagement :
- Allées sinueuses et courbes douces: Les chemins serpentent à travers le jardin, créant une sensation de découverte progressive et d’invitation à la flânerie, typique des jardins anglais et romantiques.
- Massifs foisonnants et variés: Les mixed-borders, composés de nombreuses variétés de fleurs (dont roses anciennes et anglaises, hydrangeas, vivaces), donnent un aspect naturel et spontané, tout en restant soigneusement orchestrés.
- Ambiance sensorielle: Les parfums des roses, des lilas, du chèvrefeuille et autres plantes odorantes enrichissent l’atmosphère, stimulant l’émotion et la rêverie.
- Éléments de décoration champêtres: Le pigeonnier, le petit puits, les cabanes, les gloriettes et les bancs invitent à la pause et à la contemplation, rappelant les jardins de campagne et les lieux de détente intime.
- Couleurs douces et pastel: La palette végétale privilégie les roses poudrés, les bleus lavande, les blancs et les verts tendres, pour une ambiance apaisante et élégante.
- Atmosphère familiale et conviviale: Les maisonnettes pour enfants, les coins cachés et les points de vue surprenants rendent le jardin accueillant pour tous les âges, tout en renforçant son aspect champêtre et romantique.
- Intégration de la nature sauvage: Le jardin semble laisser la nature s’exprimer, avec des formes libres, des pelouses verdoyantes et des bosquets, tout en gardant une organisation subtile et harmonieuse.
Ces éléments, combinés à la passion des propriétaires et à la diversité végétale, font du Jardin des Lianes un lieu unique, à la fois romantique, champêtre et vivant
Hydrangeas
Le Jardin des Lianes est réputé pour sa collection exceptionnelle de plus de 500 variétés d’hydrangéas, ce qui en fait l’un des jardins privés les plus riches en diversité d’hydrangeas en France.
Le jardin accueille des collections de variétés originales, dont certaines issues de sélections anglaises, et qu’il présente des hydrangeas à bois noir de la gamme créole de chez Chauvin Diffusion, tels que Punch Coco, Curaçao et Royal. Ces variétés sont considérées comme plus rares et originales dans le commerce horticole français.
Parmi les hydrangeas plus rares généralement recherchés par les collectionneurs et parfois présents dans les grands jardins comme Le Jardin des Lianes, on peut citer :
- Hydrangea seemannii: originaire du Mexique, rare en Europe, à feuillage persistant et floraison blanche.
- Hydrangea aspera ‘Macrophylla’et ‘Strigosa’ : feuilles duveteuses, grandes fleurs plates, très ornementales et moins courantes.
- Hydrangea involucrata : arbuste compact, peu courant, à fleurs tardives et feuillage velu.
- Hydrangea serrata(variétés de montagne japonaises) : certaines sélections sont rares et recherchées pour leur résistance au froid et leur floraison colorée.
Roses anciennes ou anglaises


La collection de roses anciennes ou anglaises du Jardin des Lianes se distingue par plusieurs caractéristiques majeures, qui en font l’un des points forts du jardin :
- Diversité et richesse variétale: Le jardin présente entre 400 et 450 variétés de roses anciennes et anglaises, ce qui constitue une collection exceptionnelle pour un jardin privé.
- Parfum et beauté florale: Les roses anciennes sont réputées pour leur parfum puissant et leurs fleurs très doubles, souvent en coupe ou en rosette, tandis que les roses anglaises, issues des hybridations de David Austin, combinent le parfum des anciennes avec la floraison abondante et remontante des modernes.
- Floraison et port: Les roses anciennes fleurissent généralement une seule fois par an, mais offrent un spectacle spectaculaire lors de leur floraison. Les roses anglaises, elles, fleurissent en abondance et souvent de façon remontante, tout en gardant le port souple et le feuillage dense des anciennes.
- Couleurs et formes variées: Les roses anglaises introduisent des couleurs rares chez les anciennes, comme le jaune ou l’abricot, et déclinent une large palette de nuances, du blanc au rouge profond.
- Valeur esthétique et historique: Les roses anciennes sont appréciées pour leur charme romantique et leur valeur patrimoniale, tandis que les roses anglaises incarnent l’innovation horticole, mêlant tradition et modernité.
La collection du Jardin des Lianes se distingue par son ampleur, la qualité olfactive et visuelle de ses roses, ainsi que par la combinaison unique entre l’héritage des roses anciennes et la performance florale des roses anglaises.
Adresse : 8 Rue des Capucines (62 140) Chériennes
https://www.jardindeslianes.fr/
HortensiArtois – Villers au Bois (25 kms)
HortensiArtois est un jardin et une pépinière situés à Villers-au-Bois.
Ce lieu, créé et entretenu par André Diéval, est reconnu pour sa remarquable collection d’hortensias (hydrangeas) et d’hostas.
HortensiArtois à Villers-au-Bois est une destination incontournable pour les amateurs d’hydrangeas et de jardins naturels dans le nord de la France, offrant à la fois une collection exceptionnelle, des conseils de passionné et la possibilité d’acquérir des plantes rares et robustes.


Le jardin abrite plus de 300 variétés d’hortensias, venant du monde entier, ainsi qu’une cinquantaine de variétés d’hostas.
André Diéval, horticulteur de formation, a débuté ce jardin en 1984 sur une parcelle de 3 000 m². Il y cultive également arbres, arbustes, vivaces et bambous, prônant une approche passionnée et attentive du jardinage.
Il partage volontiers ses connaissances sur la culture des hortensias, notamment sur la gestion de l’acidité du sol, la taille adaptée à chaque variété, et la sélection de plantes résistantes aux conditions climatiques changeantes.
Le jardin se distingue par sa richesse botanique et l’attention portée à la biodiversité locale (présence d’oiseaux, insectes, mammifères).
André Diéval insiste sur l’importance de la passion, de l’observation et du temps consacré au jardin pour obtenir de beaux résultats.
HortensiArtois propose la visite du jardin, véritable « tour du monde » des hydrangeas, et la vente artisanale de plants d’hortensias, de bambous et d’hostas produits sur place.
Le jardin est également un lieu d’échange entre passionnés, où André Diéval développe de nouvelles variétés par bouturage et partage ses « bébés » lors d’échanges ou de ventes.
Informations pratiques
- Adresse : Chemin de la Chapelle, 62144 Villers-au-Bois37.
- Contact : 03 21 48 00 80 (après 19h ou le week-end), hortensiartois@orange.fr
- Site web : hortensiartois.fr.
- Production artisanale, visites sur rendez-vous recommandées.
Jardins et gens du Nord : HortensiArtois - YouTube
https://youtu.be/WxGRQSxKVao?feature=shared
Pépinière Philippe LECLERCQ Billy Berclau (40 kms)
La pépinière Philippe Leclercq est reconnue pour sa spécialisation dans la production d’arbustes d’ornement rares et d’arbustes à écorce décorative. Elle propose notamment de belles collections de magnolias, fusains, cornus, aubépines, ainsi que d’autres arbustes tels que viburnum, prunus et malus.
Philippe Leclercq est un pépiniériste multiplicateur, utilisant des méthodes anciennes et naturelles, et il est particulièrement apprécié des passionnés pour la qualité et la diversité de ses végétaux, souvent sélectionnés avec soin pour leur originalité et leur adaptation au climat du nord de la France.


Plusieurs plantes rares et arbustes à écorce décorative, souvent issus de sélections originales ou peu courantes :
- Prunus serrula 'Jaro': Sélection exclusive de Philippe Leclercq, cet arbre se distingue par une écorce cuivre-caramel, plus claire que celle du Prunus serrula classique, et offre un effet très lumineux dans le jardin.
- Prunus serrula: Un incontournable pour son écorce acajou brillante, très ornementale et appréciée pour son aspect lustré.
- Heptacodium jasminoides: Arbuste rare à floraison blanche parfumée en fin d'été, suivi de fruits rouges et d'une écorce s'exfoliant joliment, idéale pour l'intérêt hivernal.
- Betula jacquemontii: Bouleau à écorce blanche immaculée, extrêmement lumineux et décoratif.
- Betula albosinensis(notamment 'Bois Marquis', var. septentrionalis, 'Princesse Sturdza') : Bouleaux à écorce rouge orangée, rose très clair ou rose orangé, apportant des couleurs originales et rares dans les jardins.
- Betula nigra 'Heritage': Bouleau à écorce crème orangé qui s’exfolie en larges lambeaux, puis fonce avec l’âge, intéressant pour les sols humides.
Ces plantes sont sélectionnées pour leur originalité, leur adaptation au climat régional et leur valeur ornementale, notamment en hiver grâce à leur écorce décorative.
Adresse : 31 rue du 11 Novembre à Billy-Berclau (62138)
Pour toute information ou commande, il est possible de contacter la pépinière par téléphone au 03 21 40 80 42 ou au 06 09 94 91 58, ou par courriel à isabelleberclau@hotmail.f
https://youtu.be/WxGRQSxKVao?feature=shared
Pépinière Jardin Antoine BREUVART à Ramecourt (20 kms)
La pépinière Jardin Antoine Breuvart à Ramecourt est une adresse incontournable pour les amateurs de plantes vivaces rustiques, de biodiversité et de nouveautés horticoles dans le Pas-de-Calais.

Spécialisée dans la production de plantes vivaces rustiques adaptées aux terres argileuses, cette pépinière propose un choix impressionnant de plus de 500 références, allant des grands classiques aux sélections maison, incluant des collections remarquables de phlox, graminées, anémones du Japon, chrysanthèmes, ainsi que des nouveautés issues du travail d'obtenteur d'Antoine Breuvart, comme des agapanthes et crocosmias uniques.
Son jardin de présentation permet d'observer les plantes en situation réelle, et l'approche respectueuse de l'environnement, sans pesticides, séduit autant les particuliers que les professionnels à la recherche de plantes robustes, originales et faciles à vivre. La pépinière se distingue aussi par son rôle de terrain d'expérimentation et d'inspiration pour des associations végétales innovantes.
La pépinière Breuvart à Ramecourt est idéale pour découvrir des plantes vivaces rustiques grâce à plusieurs atouts distinctifs :
- Spécialisation et expertise: Antoine Breuvart est un pépiniériste-obtenteur reconnu, fort de plus de 25 ans d’expérience, qui sélectionne et multiplie des vivaces adaptées aux terres argileuses et au climat du nord de la France.
- Large choix et nouveautés: Plus de 500 références sont proposées, incluant des collections remarquables de phlox, graminées, anémones du Japon, chrysanthèmes, ainsi que des créations originales comme des crocosmias et agapanthes rustiques, issues de son propre travail de sélection.
- Production locale et durable: Toutes les plantes sont produites sur place, à partir de semis, boutures ou divisions, dans un terreau contenant jusqu’à 20 % d’argile, sans aucun pesticide depuis plus de 20 ans, ce qui favorise la biodiversité et la robustesse des plantes.
- Jardin de présentation: Un jardin d’exposition permet aux visiteurs de voir les plantes en situation réelle, de s’inspirer pour des associations végétales et de recevoir des conseils personnalisés sur leur utilisation au jardin.
- Engagement écologique: La pépinière est refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et adhère à l’association Jardins Passions, soulignant son engagement pour un jardinage respectueux de la nature et de la faune locale.
- Sélection selon trois critères: Les plantes sont choisies pour leur esthétique, leur utilité au jardin et leur facilité de culture, garantissant ainsi des vivaces à la fois belles, utiles et faciles à entretenir.
En résumé, la pépinière Breuvart offre un environnement unique pour découvrir, choisir et expérimenter des vivaces rustiques robustes, originales et respectueuses de l’environnement, parfaitement adaptées aux jardins du nord de la France.
Adresse : 898 Rue Charles Chopin (62 130) Ramecourt
https://www.plante-vivace.com/
PATRIMOINE DE MÉMOIRE DES CONFLITS
Le Pas-de-Calais a été le théâtre de nombreux conflits, en particulier la Première Guerre mondiale, qui a laissé une empreinte indélébile sur le territoire. On y trouve de nombreux champs de bataille, mémoriaux, cimetières militaires et centres d’interprétation retraçant les grands événements historiques qui ont marqué la région et l’Europe.
Le patrimoine de mémoire y est exceptionnel par sa densité, sa diversité et sa reconnaissance internationale. Il englobe des cimetières, mémoriaux, blockhaus, musées et parcours historiques, qui témoignent de l’ampleur des conflits mondiaux et de l’engagement pour la paix et la transmission de l’histoire
Parmi les sites majeurs figurent l’Anneau de la Mémoire à Ablain-Saint-Nazaire, un mémorial international où sont gravés les noms de près de 580 000 soldats tombés dans le Nord-Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Ce monument, inauguré en 2014, symbolise la fraternité et la mémoire partagée entre les nations.
La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, le Mémorial canadien de Vimy et de nombreux autres cimetières et mémoriaux (français, britanniques, canadiens, indiens, tchèques, polonais, portugais et allemands) témoignent de l’ampleur des combats et du sacrifice des soldats de différentes nationalités.


Musée Alexandre Villedieu, Loos-en-Gohelle
“Visiteur, souviens-toi que derrière chaque objet, il y avait un homme”.
Ces mots qui accueillent les visiteurs du Centre d’interprétation et Musée Alexandre Villedieu sont retentissants. À l’intérieur, Gilles Payen et l’association “Loos, sur les traces de la Grande Guerre” s’affairent à conserver et transmettre la mémoire des soldats. Français, Canadiens, Britanniques, Allemands…Tous se sont battus sur la terre de Loos-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais, pour la liberté de la nation. Leur souvenir prend vie à travers les objets retrouvés après la Première Guerre mondiale, sauvés par le temps.
Passionnée et immersive, la visite de ce centre d’interprétation promet de créer des souvenirs historiques et de mieux saisir le quotidien des tranchées.
Jour après jour, dans les tranchées…
Il n’y a nul doute, Loos-en-Gohelle est une terre marquée par l’Histoire. Si cette commune du Pas-de-Calais a su renaître de ses cendres, la Première Guerre mondiale ne l’a pas laissée sans cicatrices. Théâtre de trois attaques entre 1915 et 1917, ce sont tour à tour les Français, les Britanniques et les Canadiens qui se battent pour défendre Loos, et libérer cette terre aux mains des Allemands. Bombardement, gaz, famine…Les conséquences de la guerre se font ressentir sur le champ de bataille et les paysages des Hauts-de-France se façonnent ainsi, au fil de l’histoire.
Des années plus tard, les traces laissées par les soldats durant la guerre restent gravées sur le sol français. L’histoire des poilus éveille en nous un véritable désir de mémoire : c’est le projet entrepris par l’association “Loos, sur les traces de la Grande Guerre” que l’on peut découvrir au Musée Alexandre Villedieu de Loos-en-Gohelle.
Adresse : Musée Alexandre Villedieu, Place de la République, 62750 Loos En Gohelle
Téléphone : 03 21 70 59 75
E-mail : a.villedieu@wanadoo.fr
Site : https://www.loos1915.fr/accueil
Sites de mémoire de la Première Guerre mondiale
Inscription UNESCO : En 2023, 139 sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale, répartis dans les Hauts-de-France, ont été inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette reconnaissance internationale souligne la valeur universelle exceptionnelle de ces lieux, qui honorent la mémoire de soldats de plus de 130 nations, avec une individualisation des sépultures et un hommage à chaque identité.
Ces lieux, répartis dans les départements de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme, rendent hommage aux soldats de nombreuses nations tombés lors du conflit.
Au sein de cette prestigieuse liste, on trouve six sites du Nord et quatorze du Pas-de-Calais.
Notre Dame de Lorette : Plus grande nécropole militaire française, elle symbolise le sacrifice des soldats français et étrangers sur le front d’Artois.

Avec sa position dominante et les terribles batailles dont elle fut témoin, la colline de Notre-Dame-de-Lorette s’impose dès 1919 comme lieu de commémoration du sacrifice de milliers de combattants. Aujourd’hui, le cimetière provisoire créé lors des batailles d’Artois est devenu une nécropole de regroupement de plus de 150 cimetières. Y reposent plus de 42000 soldats, faisant de Notre-Dame-de-Lorette la plus grande nécropole nationale.
Au milieu de la nécropole se dressent la tour lanterne et la basilique, veillant sur tous les soldats. Tel un phare, la lumière projetée au sommet de la tour est visible à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Les deux monuments, richement décorés, ont été conçus par l’architecte Louis-Marie Cordonnier.
À la nécropole Notre-Dame-de-Lorette, Bénévoles et répartis en plusieurs groupes, le gardes d’honneur sont plus de 4500 à donner une journée de leur temps par an afin de veiller sur la nécropole et accueillir les visiteurs en ce lieu de mémoire unique. Ils répondent à toutes les questions et peuvent aider à trouver une sépulture.
Notre Dame de Lorette est également voisine de l’Anneau de la Mémoire, monument commémoratif international.
L’Anneau de la Mémoire Ablain St Nazaire ( kms) : L’architecture singulière, comme posé à flanc de colline, est l’œuvre de Philippe Prost. L’Anneau fait plus de 345 mètres de périmètre dont 56 mètres en porte-à-faux au-dessus du vide. Cette forme unique évoque la fraternité, à la manière d’une ronde d’enfants qui se tiennent la main. Alors que le porte-à-faux rappelle l’équilibre fragile de cette paix retrouvée. Les difficultés techniques, opposées à l’épure du monument final, forcent à l’admiration et à la contemplation.


Champ de bataille de Vimy (35kms) : La crête de Vimy fut le théâtre d’une bataille décisive du 9 au 12 avril 1917, remportée par le Corps canadien.
Le site est aujourd’hui un haut lieu de mémoire, avec un mémorial et des vestiges du champ de bataille ouverts au public.
Vimy symbolise le sacrifice et la naissance d’une identité nationale canadienne, tout en étant un site majeur du patrimoine mondial de la Première Guerre mondiale
Après quatre jours de combats acharnés, les Canadiens s’emparent de la crête, au prix de plus de 10 600 tués et blessés. Cette victoire, bien que coûteuse, contraste avec l’échec des offensives alliées voisines et marque un tournant dans la reconnaissance de l’autonomie militaire canadienne.
La bataille de Vimy est devenue un symbole fort du sacrifice et de l’identité nationale canadienne. En 1922, la France a cédé à perpétuité au Canada la crête de Vimy et ses terrains environnants, où se dresse aujourd’hui le Mémorial national du Canada à Vimy, inauguré en 1936. Ce monument majestueux rend hommage aux 11 285 Canadiens morts en France sans sépulture connue et à l’ensemble des sacrifices consentis pendant la Première Guerre mondiale5.
Le site comprend également des tranchées préservées, des tunnels visitables et plusieurs lieux de mémoire, faisant de Vimy un point central du tourisme mémoriel dans la région Hauts-de-France8. Il s’inscrit dans le réseau des sites de la Première Guerre mondiale reconnus pour leur valeur historique et patrimoniale79.
Mémorial National du Canada à Vimy : Ce mémorial rend hommage aux soldats canadiens tombés lors de la bataille de la crête de Vimy. Il est l’un des sites les plus visités et les plus emblématiques de la mémoire canadienne en France.
Cimetière militaire portugais de Richebourg-l’Avoué : Unique cimetière portugais en France, il témoigne de la participation du Portugal au conflit et de la reconnaissance de ses soldats tombés sur le sol français.
Cimetière Faubourg d’Amiens, Mémorial d’Arras et Mémorial d’Arras “Flying Services”, à Arras : Ce cimetière britannique et mémorial à Arras rend hommage aux soldats du Commonwealth disparus sans sépulture connue, illustrant la dimension internationale du souvenir.
Musée Militaire de la Targette
Ce musée offre un regard approfondi sur les deux guerres mondiales avec des objets rares et une scénographie immersive, idéale pour les amateurs d’histoire militaire.

Autres sites dans le Pas-de-Calais :
- Le mémorial et cimetière indien de Neuve Chapelle, à Richebourg,
- Le cimetière canadien n°.2, à Neuville-Saint-Vaast,
- Le cimetière canadien Givenchy Road, à Neuville-Saint-Vaast,
- Le cimetière britannique La Targette, à Neuville-Saint-Vaast,
- Le cimetière allemand de Neuville-Saint-Vaast,
- Le cimetière tchécoslovaque de Neuville-Saint-Vaast.
- Le Lichfield Crater, à Thélus,
- Le cimetière Dud Corner et Mémorial de Loos-en-Gohelle,
- Le cimetière militaire d’Etaples-sur-mer,
- Le cimetière communal de Wimereux.
Patrimoine de la Seconde Guerre mondiale
Blockhaus d’Eperlecques : Plus grand blockhaus de France, classé Monument Historique, il servait de base de lancement pour les V1 et V2. Aujourd’hui, il œuvre pour la paix et propose une
Immersion dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

La Coupole (Saint-Omer) : L’un des vestiges les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale en Europe, construit par l’armée allemande pour lancer des fusées V2. Aujourd’hui, c’est un centre d’histoire et de mémoire dédié à la guerre et à la conquête spatiale.
Installé dans un ancien bunker, ce musée offre une expérience immersive autour de la Seconde Guerre mondiale, avec des expositions multimédias et un planétarium 3D, idéal pour les passionnés d’histoire et de sciences.
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/revue/le-tourisme-de-memoire-dans-les-hauts-de-france
https://www.cwgc.org/visit-us/find-cemeteries-memorials/cemetery-details/79500
http://sentierdunordhdf.free.fr/Patrimoine/Souchez/NDLor/NDLorette_sliderscroll.html
https://tourisme-lens.fr/
QUELQUES VILLES OU VILLAGES
AMETTES (9 kms)
Le nom d’Amettes apparaît dès le XIIe siècle sous différentes formes, témoignant de son ancienneté
Le village est surtout connu pour être le lieu de naissance de saint Benoît-Joseph Labre (1748-1783), figure majeure de la spiritualité chrétienne, surnommé le « vagabond de Dieu ».
La maison natale, typique de l’Artois, et l’église Saint-Sulpice sont des lieux de pèlerinage importants, accueillant chaque année des milliers de visiteurs, notamment lors de la fête de saint Benoît Labre le 16 avril et lors de la neuvaine annuelle à la fin de l’été.
BETHUNE (20 kms)
Béthune fait partie des Flandres artésiennes, à proximité de grandes villes comme Lens, Arras et Lille.


Historiquement, Béthune est une ville ancienne fondée dès le VIIIe siècle sous le nom de Bitunia. Elle a connu une occupation humaine depuis la préhistoire, avec des vestiges néolithiques et gallo-romains. Au Moyen Âge, elle s’est développée autour de remparts et d’une grand-place ornée d’un beffroi du XIVe siècle, symbole de son riche patrimoine architectural.
Béthune est également connue comme « la cité de Buridan ». Son centre-ville est marqué par une vaste place carrée et un beffroi classé au patrimoine.
Béthune est une ville au riche passé historique et culturel, située dans une région agricole fertile, qui joue un rôle central dans une grande agglomération régionale tout en poursuivant sa transformation économique et urbaine.
- Les façades de la Grand'Place
La Grand'Place de Béthune fut la cible de nombreux bombardements et fut détruite à plus de 90 % pendant la Première Guerre mondiale. Pour sa reconstruction, on fit appel aux architectes Jacques Alleman, Paul Dégez et Léon Guthmann. Désireux de respecter le passé de Béthune tout en œuvrant pour la modernité, ils optèrent pour un style éclectique, mêlant Art déco et architecture régionaliste. Ce choix audacieux fait aujourd'hui l'originalité et le charme du centre-ville !
- Un hôtel de ville style Art déco avec des vitraux, des ferronneries et des mosaïques.
En 2001, il fut classé Monument historique pour ses superbes vitraux en dalles martelées, ses ferronneries et ses mosaïques.
- Le beffroi
En 1346, vaillance et fidélité à la couronne de France valent à la ville de Béthune son tout premier beffroi. En 1388, suite à son effondrement, les échevins sont autorisés à ériger un second beffroi. Le carillon est installé en 1546 et sera complété en 1553 par Charles Quint avec les cloches de l'abbaye de Thérouanne. Pendant la Première Guerre mondiale, les bombardements détruisent le campanile mais les maisons qui l'entourent protègent sa structure. Le beffroi s'élève aujourd'hui sur quatre niveaux et l'accès aux étages se fait par la tourelle d'angle sud-est.
- La Chapelle Saint Pry
Construite en 1828, la chapelle Saint-Pry est l'ultime vestige de l'ancien hôpital civil de Béthune. La ville a en effet subi de lourdes destructions lors de la Première Guerre mondiale. Depuis 2009, la chapelle, qui a été désacralisée et entièrement rénovée en 1992, est devenue un espace culturel de 200 m2 ouvert à tous gratuitement, une fort belle galerie qui accueille ainsi trois ou quatre expositions chaque année, puisant généralement dans le riche fonds du Musée d'ethnologie régionale, une collection d'environ 30 000 objets d'arts et traditions populaires.
Le Musée d’Ethnologie Régionale, Musée de France localisé à Béthune, a la caractéristique d’être le seul musée sur le territoire régional à interroger les évolutions sociales et les mutations comportementales sous l’angle de l’ethnologie.
- La Comédie de Béthune
Bâtiment de béton lasuré pourpre avec une façade italienne, la Comédie de Béthune ne passe pas inaperçue… tant et si bien d’ailleurs que les Béthunois eux-mêmes la surnomment le Blockhaus. Pourtant la Comédie de Béthune n’est pas du tout un lieu fermé, bien au contraire. Ici, on partage, on échange, on vibre et on s’émeut ensemble autour de créations éclectiques. L’ambition de la Comédie, qui est aussi le Théâtre des pays du Nord, est de favoriser l’accès de tous à la culture et permettre la découverte de formes scéniques variées. Humanité, fraternité, mais aussi respect du patrimoine et de l’histoire sont les maîtres mots de cet établissement exigeant. La Comédie a en effet pris ses quartiers dans l’ancien célèbre cinéma béthunois le Palace qui accueillit jadis de grandes vedettes telles qu'Edith Piaf ou Yves Montand. La Comédie de Béthune est aussi un lieu à découvrir et à visiter, notamment lors des Journées du Patrimoine, un moment idéal pour découvrir l’envers du décor. Un incontournable de la scène culturelle régionale !
- L’Eglise Saint Vaast
Construite sur ordre de Charles Quint en 1547, l'église Saint-Vaast n'a pas survécu aux bombardements de la Première Guerre mondiale : elle fut totalement détruite en 1918. Pour sa reconstruction (de 1924 à 1927), Louis-Marie Cordonnier s'est inspiré de l'art byzantin et de l'Art déco pour apporter de la lumière dans l'édifice. Des vitraux retracent la vie de saint Vaast, l'histoire moderne de la ville, ainsi que les statues de Réal del Sarte. Fabriqué en Allemagne, l'orgue de l'église est un exemplaire unique en France.
- La Chambre des charitables de Saint-Éloi, fondée en 1188 à Béthune.
Fondée en 1188, la Confrérie des Charitables de Saint-Éloi est l'une des plus anciennes du pays. Pendant une épidémie de peste, deux maréchaux-ferrants, Germon et Gauthier, croisèrent la route de saint Éloi qui leur demanda de fonder une CHARITE pour aider les pauvres, donner des soins aux malades et enterrer les morts quelle que soit leur condition. Une chapelle a été érigée dans le parc de Quinty, sur les lieux de la fameuse rencontre des fondateurs avec le saint.
- Labanque
Installée dans l’ancienne succursale de la Banque de France de Béthune, Labanque offre plus de 1500 m² d’espaces d’exposition répartis sur quatre niveaux avec la découverte d’espaces exceptionnels : le bureau du directeur, la salle des coffres, la serre des monnaies, la salle des archives, l’appartement de fonction du directeur.
Des expositions d’art contemporain sont organisés : des artistes plasticiens sont invités à créer et présenter leurs dernières créations dans des champs aussi diversifiés que la photographie, la vidéo, la sculpture, la peinture, le design, etc.
- Le Golf de Béthune
Le golf de Béthune est un golf dit "urbain" créé en 1996 sous sa forme actuelle et à moins d'un kilomètre de la Grand Place. Parcours de 9 trous, plat et boisé, idéal pour s'initier, s'entrainer ou se perfectionner. Le golf se compose d'une succession de par 3 sur environ 1 kilomètre. Leurs distances varient de 80 à 195 mètres. Un practice de 17 postes (dont 9 couverts) est également à disposition.
- Office de tourisme labellisé Tourisme & Handicap à Béthune, un repère obligé pour ne rien manquer des incontournables de la ville.
À Béthune, quasiment tous les monuments et grands points d'intérêt se visitent sur réservation. N'oubliez donc pas d'appeler avant votre arrivée pour avoir vos places ! L'office est labellisé Qualité Tourisme et Tourisme & Handicap pour les 4 handicaps.
https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/
BRUAY LABUISSIERE (8 kms)

Historiquement, Bruay-la-Buissière fut un centre majeur de l’exploitation charbonnière, notamment grâce à la Compagnie des mines de Bruay qui y a exploité plusieurs fosses entre 1850 et 1978. Ce passé minier a profondément marqué la ville, dont la Cité des Électriciens, la plus ancienne cité minière du Nord-Pas-de-Calais, est aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des « Paysages culturels évolutifs ». Réhabilitée entre 2014 et 2019, la cité abrite un écomusée consacré au patrimoine industriel du bassin minier.
La ville possède également un riche patrimoine architectural et culturel, avec notamment l’église Saint-Éloi-et-Saint-Martin de La Buissière (XVIe siècle, rénovée après-guerre), inscrite aux monuments historiques, ainsi que des vitraux remarquables dans l’hôtel de ville, un donjon, la Tour de Lambres, et le musée de la mine.
Enfin, La piscine Art déco de Bruay-la-Buissière, véritable joyau architectural et patrimonial, offre une expérience unique mêlant baignade, histoire et esthétique des années 1930.
Les principales caractéristiques historiques de Bruay-la-Buissière sont marquées par plusieurs phases clés :
- Origines médiévales et seigneuriales : La localité de Bruay est mentionnée dès le Moyen Âge, intégrée dans les terres de Béthune, et connaît une certaine prospérité agronomique au XIIIe siècle. Elle subit les attaques flamandes pendant la guerre de Cent Ans et passe sous domination espagnole au XVIe siècle avant d’être rattachée définitivement à la France par le traité des Pyrénées en 1659. En 1603, la terre de Bruay est érigée en comté au profit de Gaston Spinola.
- Développement minier : Avant 1850, Bruay-en-Artois n’est qu’un petit village rural. Le véritable essor débute avec l’implantation de la Compagnie des mines de Bruay à partir de 1850, qui exploite plusieurs fosses sur son territoire. La population explose : de 700 habitants en 1855, elle passe à 18 000 en 1913, puis à plus de 31 000 en 1946. La ville devient un centre majeur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, avec une forte immigration ouvrière, notamment polonaise, après la Première Guerre mondiale.
- Patrimoine minier et ouvrier : La ville conserve des traces importantes de cette histoire, notamment la Cité des Électriciens, la plus ancienne cité minière du Nord-Pas-de-Calais, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les corons et autres cités minières témoignent de l’organisation sociale et urbaine liée à l’industrie charbonnière.
- Restructuration et modernisation : Avec la fin de l’exploitation minière en 1978, la ville s’engage dans une politique de restructuration urbaine dès les années 1970, avec la création de nouveaux quartiers, la rénovation des logements, et le développement d’équipements publics. La rénovation urbaine se poursuit au XXIe siècle avec la démolition de barres d’immeubles et la requalification de quartiers.
- Patrimoine architectural : Bruay-la-Buissière possède un riche patrimoine bâti, comprenant des édifices historiques comme l’église Saint-Éloi-et-Saint-Martin (XVIe siècle), l’hôtel de ville (1927, inscrit aux monuments historiques), le donjon du château de La Buissière (1310), ainsi que des bâtiments industriels et des équipements publics remarquables.
- Piscine art déco
Chef-d'œuvre unique en France, cette piscine de plein air inscrite aux Monuments historiques séduit par son architecture 'paquebot' typique de l'Art déco, ses bassins, solariums et plongeoirs, et son ambiance authentique des années 1930. Elle propose une eau chauffée, des activités variées (natation, aquagym, aquabike), et reste l'une des rares piscines Art déco encore ouvertes à la baignade, bien qu'elle puisse paraître un peu vétuste pour les nageurs exigeants, ce qui fait tout son charme pour les amateurs de patrimoine.
LENS (30 kms)
Lens est reconnue pour son dynamisme culturel, son patrimoine minier, et ses équipements modernes, dont le musée du Louvre-Lens, installé sur l’ancien site minier. La ville est également célèbre pour son club de football, le Racing Club de Lens, qui joue un rôle important dans l’identité locale, et son patrimoine ART DECO.
Lens est un véritable livre d’architecture Art déco à ciel ouvert, où la gare, la place Jean Jaurès, les anciens bureaux des mines et de nombreuses façades du centre-ville racontent l’histoire de la reconstruction et du renouveau de la ville après la Première Guerre mondiale


Son histoire remonte au haut Moyen Âge, avec une première mention sous le nom de Lenna Cas à l’époque mérovingienne, signifiant « Forteresse des Sources ». Au fil des siècles, Lens a connu plusieurs dominations : comté de Flandre, Pays-Bas bourguignons, puis, à partir du XVIe siècle, Pays-Bas espagnols, avant de devenir française après le traité des Pyrénées en 1659.
Lens s’est développée comme une place commerciale et militaire importante, dotée de remparts, d’un château et de franchises communales au XIIIe siècle. Elle a subi de nombreux sièges et destructions, notamment pendant la Guerre de Cent Ans et les guerres du XVIIe siècle, avant d’être reconstruite à plusieurs reprises.
Le véritable essor de Lens s’est produit au XIXe siècle avec la découverte du charbon, qui a transformé la ville en un centre industriel majeur du bassin minier du Pas-de-Calais. La Compagnie des mines de Lens, créée en 1852, a entraîné une forte croissance démographique et une transformation radicale du paysage, avec l’apparition de puits de mine, de chevalets et de cités ouvrières, les fameux corons.
La ville a été sévèrement touchée par les deux guerres mondiales, entièrement détruite lors de la Première Guerre mondiale puis reconstruite dans l’entre-deux-guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, Lens a connu le déclin de l’exploitation charbonnière, l’arrêt total de l’extraction en 1986, puis une reconversion économique et urbaine.
- LE RACING CLUB DE LENS (RCL)
Le Racing Club de Lens (RCL) incarne profondément l’identité locale de Lens et du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Fondé en 1906, le club a grandi en parallèle de l’essor industriel de la région, devenant un symbole fort de la communauté ouvrière et minière. Les couleurs « sang et or » du club, adoptées en 1923, sont un hommage à l’occupation espagnole de Lens au XVIe siècle et aux racines catalanes de nombreux habitants venus travailler dans les mines. Ces couleurs sont devenues un emblème de fierté régionale et de ralliement pour les supporters.
Le RCL est souvent surnommé le club des « Gueules noires », en référence aux mineurs du bassin minier, et il est perçu comme un vecteur d’intégration sociale, reflétant la diversité de la population locale, marquée par des vagues migratoires successives, notamment polonaises. Le club a joué un rôle central dans la construction d’une identité collective, permettant aux habitants de revendiquer leur passé minier, même après la fermeture des mines, à travers des symboles comme la lampe de mineur sur le blason ou la présence de casques dans les tribunes.
Le stade Bollaert-Delelis, véritable cœur battant de la ville, a été érigé en centre symbolique de Lens, incarnant la municipalisation du territoire et la « victoire » sur le patronat minier.
Le RCL est ainsi plus qu’un simple club de football : il est un support d’identité sociale et locale, transmettant des valeurs de courage, de solidarité et de fierté du travail bien fait, héritées de la mine et portées sur le terrain. Aujourd’hui, le slogan « Fier d’être lensois » résume cette connexion indissociable entre le club, la ville et ses habitants.
Le « supportérisme » du Racing Club de Lens (RCL) joue un rôle central dans la transmission et la vivification de l’héritage minier du territoire. Il permet aux supporters de continuer à s’approprier et à revendiquer une identité minière, même après la fermeture des Houillères et la disparition progressive de la communauté minière traditionnelle.
Cette appropriation se manifeste de plusieurs façons :
- Symboles et rituels: Les supporters arborent des casques de mineurs (ou des casques de chantier, évoquant la mine) dans les tribunes, rappelant la mémoire des « Gueules noires » et perpétuant cette image emblématique du bassin minier.
- Mythologie et récits: Le « supportérisme » entretient une mythologie autour de la mine, nourrissant un imaginaire collectif qui valorise le courage, la solidarité et la fierté du travail ouvrier. Ce récit participe à la construction et à la reconstruction d’une identité locale, en réponse à la transformation sociale du territoire.
- Continuité et adaptation: Alors que la société locale se transforme et que la communauté minière se délite, le club et ses supporters proposent une forme de continuité. Ils permettent aux habitants de rester connectés à leur histoire, en réinventant parfois les pratiques et les symboles pour qu’ils restent pertinents dans le contexte contemporain.
En somme, le « supportérisme » lensois fait vivre l’héritage minier non seulement par la mémoire des anciens, mais aussi par la capacité des nouvelles générations à s’approprier et à réinterpréter cet héritage, en maintenant vivace la fierté d’appartenir à un territoire marqué par l’industrie charbonnière.
- Musée du Louvre Lens
Le Louvre-Lens est un musée d’art situé sur l’ancien site minier de la fosse n°9, symbolisant ainsi le renouveau culturel et économique du bassin minier.
Il incarne une politique de décentralisation culturelle et de démocratisation de l’art, devenant un modèle d’inclusion et d’accessibilité universelle5.
Conçu par les architectes japonais Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa (agence SANAA), le bâtiment s’intègre dans un parc de 20 hectares.
Les principaux espaces d’exposition sont la Galerie du Temps, le Pavillon de Verre et la Galerie des expositions temporaires.
La Galerie du Temps, d’une surface de 3 000 m², présente plus de 200 œuvres majeures du Louvre, offrant un parcours chronologique de 5 000 ans d’histoire de l’art, du 4e millénaire avant notre ère au milieu du XIXe siècle.
Le Louvre-Lens ne possède pas de collections propres mais accueille régulièrement des œuvres du musée du Louvre, renouvelées chaque année.
Deux grandes expositions temporaires sont organisées chaque année, ainsi que des expositions thématiques dans le Pavillon de Verre.
Parmi les œuvres présentées, on retrouve des chefs-d’œuvre tels que La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne, le Sarcophage des Époux, La Madeleine à la veilleuse et La Liberté guidant le peuple.
Le Louvre-Lens est un musée innovant, ouvert à tous, qui met en valeur les collections du Louvre dans une scénographie inédite et accessible.
- L’Art déco à Lens
Après la Première Guerre mondiale, Lens a été détruite à plus de 90%. Sa reconstruction, menée dans les années 1920, a profondément marqué l’architecture de la ville, faisant de l’Art déco le style emblématique de cette renaissance.
Gare de Lens : La gare, reconstruite dans un style Art déco, est célèbre pour sa forme évoquant une locomotive. Elle se distingue par sa sobriété et ses mosaïques d’inspiration cubiste à l’intérieur, un élément rare pour un lieu de passage.
Place Jean Jaurès : Le cœur historique de Lens présente de nombreuses façades Art déco, notamment ornées de guirlandes sculptées de fleurs et de fruits, de grandes baies vitrées et de vitrines habillées.
Anciens Grands Bureaux de la Société des Mines de Lens : Ce bâtiment, qui abritait la direction des mines, possède des décors signés par de grands noms de l’époque comme Daum ou Majorelle. L’intérieur, notamment l’étage Prestige, est un exemple remarquable du raffinement Art déco appliqué à l’architecture industrielle.
Maisons et commerces du centre-ville : De nombreuses maisons individuelles et commerces du centre-ville affichent des façades colorées, des lignes géométriques et des motifs floraux stylisés typiques de l’Art déco.
Le Printemps de l’Art déco est un événement régional majeur qui met en lumière le patrimoine Art déco de Lens à travers une programmation dense et variée, accessible à tous les publics.
En fédérant plusieurs villes et en proposant une programmation commune, le Printemps de l’Art déco renforce l’identité régionale, attire un public national et international, et contribue à la reconnaissance du patrimoine de Lens au sein du Bassin minier, inscrit à l’UNESCO.
Liens utiles :
https://tourisme-lens.fr/
https://www.louvrelens.fr/
ARRAS (40 kms)
Arras, capitale historique du Pays d’Artois dans le Pas-de-Calais, est une ville réputée pour son riche patrimoine architectural, notamment ses deux places baroques uniques en Europe avec les influences classiques et flamandes, son beffroi et sa citadelle, qui sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Détruite à plus de 50 % pendant le conflit, Arras a été un laboratoire de la Reconstruction dans les années 1920-1930, période durant laquelle l’Art déco s’est imposé comme style phare.
Marquée par une histoire millénaire et un profond renouveau après la Première Guerre mondiale, Arras compte 225 édifices protégés au titre des monuments historiques, ce qui en fait la ville française avec la plus grande densité de monuments historiques classés.
Arras offre un patrimoine historique exceptionnel, mêlant architecture unique, sites militaires, lieux de mémoire et témoignages de son riche passé.
Aujourd’hui, Arras est une ville dynamique avec une vie culturelle riche, notamment grâce au Main Square Festival, un événement musical annuel qui attire des artistes internationaux. La ville possède également un théâtre à l’italienne datant de 1785 et organise un festival international des arts de la scène par l’Université d’Artois.


Historiquement, Arras était un grand centre religieux et une cité prospère connue pour ses fabrications drapières. La ville est également un berceau de la culture littéraire picarde.
Durant la Première Guerre mondiale, Arras a subi d'importantes destructions, étant proche du front et théâtre de batailles majeures. La ville a aussi accueilli une base secrète souterraine.
- L’Art déco à Arras
La ville s’illustre par une production Art déco teintée de régionalisme, visible aussi bien sur les façades d’immeubles privés que dans les bâtiments publics et religieux. Ce style se manifeste par des formes géométriques, des décors stylisés et un goût pour les matériaux nobles, parfois mêlés à des références à l’architecture traditionnelle locale. Si certains édifices Art déco majeurs ont disparu, de nombreux témoignages subsistent dans le tissu urbain, notamment dans les rues élargies après la guerre.
- Un patrimoine architectural exceptionnel
Les places d’Arras : La Grand’Place et la place des Héros, ces deux places baroques, forment un ensemble architectural unique en Europe, avec leurs façades flamandes et leurs arcades élégantes et figurent parmi les plus belles places d’Europe.
Les deux places sont bordées par 155 façades aux styles baroque flamand et classique français du XVIIe siècle, caractérisées par leurs pignons à volutes, leurs arcades soutenues par 345 colonnes, et leurs maisons aux façades richement décorées.
Ces places ont été presque entièrement détruites pendant la Première Guerre mondiale et ont été fidèlement reconstruites entre 1919 et 1934, sous la direction de l’architecte Pierre Paquet, qui s’est appuyé sur des documents anciens et des photographies pour restituer leur aspect d’origine.
L’Hôtel de Ville : l'Hôtel de Ville d'Arras est un bâtiment remarquable, combinant un corps Art déco avec un style gothique flamboyant, indissociable de son célèbre beffroi.
Symbole de la renaissance d’Arras, l’Hôtel de Ville, reconstruit après 1914 sous la direction de l’architecte Pierre Paquet, associe un intérieur Art déco raffiné à une façade néo-gothique flamboyante.
Le beffroi : classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le beffroi domine la ville et rappelle son histoire médiévale. Il est l’un des symboles majeurs d’Arras. Monter au sommet offre une vue panoramique spectaculaire sur la ville et ses alentours.
La cathédrale et le palais Saint-Vaast : Ces monuments, également reconstruits sous la houlette de Pierre Paquet, illustrent la synthèse entre tradition et modernité. Leurs décors intérieurs, réalisés par des artistes de renom, témoignent du renouveau des arts décoratifs de l’entre-deux-guerres.
La Citadelle d'Arras : La citadelle d’Arras, construite entre 1668 et 1672 par l’ingénieur militaire Vauban sur ordre de Louis XIV, est un remarquable exemple d’architecture militaire du XVIIe siècle.
Elle séduit autant pour ses bastions, ses douves et sa chapelle Saint-Louis
Elle fait partie des douze sites majeurs de Vauban inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008.
La citadelle n’a jamais été attaquée, car sa position, trop en retrait de la frontière, la rendait peu stratégique. Ce manque d’utilité militaire lui a valu le surnom de « la Belle inutile ».
Les Boves d’Arras : Les Boves d’Arras sont un vaste réseau de galeries souterraines creusées dans la craie sous la ville, s’étendant sur environ vingt kilomètres à une profondeur d’environ 12 mètres. Ces anciennes carrières, exploitées dès le Xe siècle, ont fourni la pierre nécessaire à la construction des bâtiments d’Arras, notamment ceux des célèbres places de la Grand’Place et de la Place des Héros.
Les Boves ont joué un rôle stratégique pendant les conflits, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Elles ont servi d’abris et de refuges pour la population civile et les soldats, notamment les troupes du Commonwealth. Les galeries souterraines ont permis de protéger les habitants des bombardements et des sièges, et les nombreuses inscriptions et graffitis laissés par les soldats témoignent de leur importance pendant l’offensive de 1917.
La carrière Wellington : La Carrière Wellington, nom d’une capitale en Nouvelle-Zélande, est un lieu de mémoire poignant, illustrant l’importance d’Arras dans l’histoire mondiale. Si les Boves sont un vaste réseau de galeries souterraines historiques, principalement liées à l’extraction de la craie et à l’histoire civile d’Arras, la Carrière Wellington est une partie de ce réseau creusée par des tunneliers néo-zélandais pendant la Première Guerre mondiale pour préparer la bataille d’Arras et abriter les soldats avant l’offensive de 1917. Elle est un site souterrain emblématique de la Première Guerre mondiale et constitue un mémorial majeur et un témoignage poignant de l’ingéniosité militaire et du courage des soldats alliés durant le conflit.
La cathédrale Notre-Dame de l’Assomption et Saint-Vaast : C’est un imposant édifice néoclassique du XVIIIe siècle, situé à proximité du centre-ville.
Cette cathédrale impressionne par sa taille, son orgue majestueux et son histoire, ayant été reconstruite après la Première Guerre mondiale.
AIRE SUR LA LYS (23 kms)
Aire-sur-la-Lys est surnommée « la Belle du Pas-de-Calais » pour la richesse de son patrimoine : collégiale Saint-Pierre, chapelles, beffroi (classé à l’Unesco), hôtel de ville, Grand Place et Bailliage.
Elle a été une place forte disputée, subissant de nombreux sièges entre le XIIe et le XVIIIe siècle, en raison de sa position stratégique entre Flandre et Artois.



Ce qui rend le centre historique d’Aire-sur-la-Lys unique :
Le centre historique d’Aire-sur-la-Lys se distingue par plusieurs caractéristiques remarquables qui en font un ensemble patrimonial exceptionnel dans la région des Hauts-de-France :
- Un patrimoine architectural exceptionnel et homogène
Le centre-ville conserve un tissu urbain quasiment intact du XVIIe siècle, avec de nombreuses rues étroites et sinueuses, typiques des villes flamandes médiévales, et une grande homogénéité architecturale de style classique français, résultat de la reconstruction après.
- Des monuments emblématiques
Aire-sur-la-Lys compte cinq monuments majeurs :
- La collégiale Saint-Pierre (XVIe-XVIIIe siècles), véritable chef-d’œuvre religieux
- Le Bailliage (début XVIIe siècle), joyau de la Renaissance flamande
- La chapelle Saint-Jacques (XVIIe siècle), exemple du baroque néerlandais
- Le beffroi, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, accolé à l’hôtel de ville
- L’hôtel de ville lui-même, avec sa façade monumentale sur la Grand-Place
- La Grand-Place et ses abords
Centre névralgique de la ville, la Grand-Place est entourée de maisons à pilastres colossaux, du Bailliage, de l’hôtel de ville et du beffroi, offrant un décor urbain spectaculaire et unique dans la région.
- Des vestiges de fortifications et un passé militaire
Le centre est délimité par des boulevards qui ont pris la place des anciennes fortifications. On retrouve encore la porte de l’Arsenal et de nombreux témoignages de l’histoire militaire de la ville, autrefois place forte stratégique et théâtre de nombreux sièges.
- Un réseau de places et de cours d’eau
Le centre historique est ponctué de nombreuses places (Saint-Pierre, des Béguines, du Rivage, etc.) et traversé par la Lys et la Laquette, conférant à la ville un charme particulier et une grande diversité d’ambiances.
- Des équipements culturels et une vie associative dynamique
La salle du Manège, l’AREA, l’école de musique et la bibliothèque enrichissent la vie culturelle et témoignent de la vitalité du centre-ville5.
En résumé, le centre historique d’Aire-sur-la-Lys est unique par la richesse et la diversité de son patrimoine, la préservation de son tissu urbain ancien, la concentration de monuments remarquables et l’atmosphère authentique d’une ville à la croisée des influences flamandes, artésiennes et françaises. C’est un véritable livre d’histoire à ciel ouvert.
Aire-sur-la-Lys est considérée comme une ville fortifiée historique
Aire-sur-la-Lys est considérée comme une ville fortifiée historique en raison de son impressionnant système de défense, développé et adapté du Moyen Âge au XIXe siècle, qui a profondément marqué son urbanisme et son patrimoine.
- Origine médiévale et rôle stratégique :
Dès le IXe siècle, Aire-sur-la-Lys se dote d’un castrum pour résister aux invasions normandes, puis d’une première enceinte fortifiée vers 1200, comprenant un château carré, une enceinte rectangulaire et un fossé en eau. Sa position au confluent de la Lys et du Mardyck, à la frontière de la Flandre et de l’Artois, en fait une place forte convoitée et souvent assiégée.
- Évolution des fortifications :
Les fortifications sont renforcées à plusieurs reprises, notamment sous Charles Quint au XVIe siècle (construction du bastion des Chanoines en 1541), puis par Vauban à la fin du XVIIe siècle (bastion de Thiennes). La ville subit de nombreux sièges, ce qui conduit à une modernisation constante de ses défenses : bastions, portes fortifiées, ouvrages hydrauliques (batardeaux, inondations défensives) et forts extérieurs.
- Ville du Pré Carré de Vauban :
Aire-sur-la-Lys intègre le « Pré Carré » de Vauban, ce double cordon de places fortes voulu par Louis XIV pour protéger la frontière nord du royaume de France. Elle devient alors une pièce maîtresse du dispositif défensif français.
- Vestiges et patrimoine actuel :
Bien que les fortifications aient été en grande partie démantelées à la fin du XIXe siècle, la ville conserve des éléments majeurs : porte de Beaulieu, porte de l’Arsenal, bastion des Chanoines, bastion de Thiennes, poudrières, ouvrages hydrauliques, et un plan urbain marqué par ses anciens remparts.
- Mémoire vivante et valorisation :
Le patrimoine fortifié d’Aire-sur-la-Lys est mis en valeur à travers des visites, des expositions (plan relief de 1745), et une intégration dans les circuits touristiques du territoire.
En quoi la ville a-t-elle évolué depuis ses origines en 847
Depuis ses origines en 847, Aire-sur-la-Lys a connu une évolution profonde, passant d’un simple établissement rural à une ville structurée, dynamique et dotée d’un riche patrimoine.
- Du village fortifié à la ville médiévale
À l’origine, Aire-sur-la-Lys n’était qu’une villa sur un léger relief, protégée par un castrum pour résister aux invasions. Au fil des siècles, l’urbanisation s’accélère : l’essor des marchés, la spécialisation des habitants dans le commerce et l’artisanat, et la création de bourgs fortifiés transforment la ville en un centre d’échanges et de vie communautaire. L’apparition de remparts et de quartiers spécialisés autour des places et des églises marque cette période.
- Développement économique et social
Grâce à l’accumulation de surplus agricoles et à l’amélioration des techniques, la population augmente et l’activité économique se diversifie. Les échanges commerciaux deviennent le moteur de la croissance urbaine, attirant artisans, marchands et bourgeois, qui s’organisent en communes et participent à la gestion de la cité.
- Transformation du tissu urbain
Entre le Moyen Âge et l’époque moderne, Aire-sur-la-Lys s’équipe d’institutions administratives, de marchés, d’hôpitaux et d’écoles, tout en renforçant ses fortifications pour faire face aux conflits et aux sièges. Le centre-ville se densifie, les rues s’organisent autour des places et des monuments, et la ville devient un pôle régional important.
- Modernisation et ouverture
À partir du XVIIIe siècle, la ville évolue avec la disparition progressive des remparts, l’extension des quartiers, l’arrivée de nouveaux équipements publics et l’intégration dans les réseaux de transport modernes. Le patrimoine médiéval et classique est préservé, tout en accueillant des fonctions contemporaines
Aire sur La Lys vers la transition écologique
Aire-sur-la-Lys s’inscrit activement dans la dynamique de transition écologique à l’échelle locale et communautaire.
Actions et orientations clés :
- Performance énergétique : La ville s’engage dans la réhabilitation de bâtiments publics pour atteindre le niveau basse consommation (BBC).
- Énergies renouvelables : L’agglomération vise à doubler la production d’énergies renouvelables et de récupération d’ici 2030, notamment par la promotion du solaire, de la biomasse et de l’éolien.
- Adaptation au changement climatique : Des actions sont menées pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, renforcer la biodiversité, gérer l’eau et lutter contre l’érosion des sols.
- Urbanisme durable : Aire-sur-la-Lys a intégré le développement durable dans son Plan Local d’Urbanisme, avec la création d’un futur écoquartier, la préservation des paysages et de la plaine agricole, et un développement urbain recentré pour limiter l’artificialisation des sols.
- Mobilisation citoyenne et associative : Des associations locales, comme la DPPM, sensibilisent le public à la protection des milieux aquatiques et à la biodiversité, et initient des actions d’éducation à l’environnement.
- Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) : Ce plan, adopté à l’unanimité, fixe des objectifs ambitieux pour 2030 : réduction de 13 % de la consommation énergétique, de 26 % des émissions de gaz à effet de serre et multiplication par cinq de la production d’énergies renouvelables sur le territoire.
- Contrat de Transition Écologique (CTE) : Aire-sur-la-Lys fait partie des communes bénéficiaires de ce dispositif, qui finance des projets concrets pour la transition énergétique et écologique, avec 12 opérations structurantes et 28 millions d’euros engagés à l’échelle de l’agglomération.
- Sensibilisation et formation : Un besoin identifié de formation des professionnels du bâtiment et de sensibilisation du public à l’usage des matériaux à faible impact écologique.
LILLE (60 kms)
Lille est la capitale du département du Nord et de la région Hauts-de-France. Elle est positionnée sur la rivière Deûle, à environ 219 km au nord-nord-est de Paris et proche de la frontière belge. Avec une population intra-muros de 238 695 habitants en 2022, Lille est la dixième commune la plus peuplée de France et la principale ville de la Métropole européenne de Lille, qui regroupe 95 communes et près de 1,2 million d’habitants.
Historiquement, Lille est une ville ancienne, fortifiée dès le XIe siècle, et a connu plusieurs occupations et sièges, notamment par Louis XIV en 1667 et lors des guerres mondiales. Elle a été un centre industriel majeur, notamment dans le textile, la mécanique et la chimie, avant une transition vers les secteurs tertiaires et technologiques à partir des années 1990.
Aujourd’hui, Lille est reconnue pour son dynamisme économique, son patrimoine historique avec un centre-ville ancien caractérisé par des maisons en brique rouge et la Grand’Place, ainsi que pour ses infrastructures modernes comme le quartier d’affaires Euralille et les liaisons ferroviaires à grande vitesse vers Londres, Bruxelles et Paris. La ville accueille aussi une importante population étudiante avec plus de 110 000 étudiants, notamment à l’Université de Lille et à l’Université catholique de Lille, et organise des événements culturels majeurs comme la Braderie de Lille et Lille 3000.
En résumé, Lille est une métropole historique et dynamique, à la fois centre culturel, universitaire, économique et de transport majeur dans le nord de la France et en Europe.



Lille est une ville qui ravit les visiteurs avec son mélange de charme historique, de culture dynamique et de quartiers diversifiés.
Voici les principales attractions et quartiers à ne pas manquer aujourd’hui.
- Vieux-Lille (Vieille Ville)
Le Vieux-Lille est le quartier le plus pittoresque de la ville, connu pour ses rues pavées, son architecture flamande, ses boutiques chics et ses cafés animés, parfaits pour flâner, faire du shopping et s’imprégner de l’atmosphère unique de Lille.
- Colonne de la Déesse
Le monument commémore la victoire de Lille sur les troupes autrichiennes en 1792 et sa résistance pendant le siège.
Le monument est situé sur une place très fréquentée, qui peut être bondée, surtout aux heures de pointe ou lors d’événements.
La Grand Place est le cœur dynamique de Lille, encadré par des bâtiments historiques et animé de cafés, de bars et de gens, idéal pour observer les gens et profiter de l’énergie de la ville.

- Palais des Beaux-Arts de Lille
L’un des principaux musées des beaux-arts de France, le Palais des Beaux-Arts abrite une impressionnante collection de chefs-d’œuvre européens, ce qui en fait un incontournable pour les amateurs d’art.
- Citadelle de Lille
La citadelle est un exemple remarquable de l’architecture militaire et de l’histoire de Vauban.
Le site offre de vastes espaces verts idéaux pour la marche, les pique-niques et les activités de plein air.
Cette forteresse en forme d’étoile du XVIIe siècle est entourée d’un parc pittoresque, proposant des visites guidées, un zoo et des espaces verts adaptés aux familles, combinant histoire et loisirs en un seul arrêt.

- Beffroi de Lille
Il faut monter dans ce beffroi classé au patrimoine mondial de l’UNESCO pour profiter d’une vue panoramique sur la ville ; son architecture Art déco remarquable et son importance historique en font un monument remarquable.

- Cathédrale Notre Dame de la Treille
Cette cathédrale néogothique se distingue par sa façade moderne et abrite un musée d’art sacré, mêlant ancien et nouveau au cœur du Vieux-Lille.



La Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille à Lille est considérée comme un incontournable pour plusieurs raisons majeures. D’abord, son architecture est un mélange unique de style néo-gothique traditionnel et d’éléments modernes, notamment sa façade achevée en 1999 qui allie pierre classique et design contemporain, ce qui lui confère un charme très particulier et une forte présence visuelle en plein cœur de la ville.
Ensuite, la cathédrale possède une histoire riche : elle a été construite à partir de 1854 pour remplacer une ancienne église détruite pendant la Révolution française et pour affirmer le statut religieux de Lille, notamment durant la période de l’industrialisation, ce qui en fait un symbole de résilience et de foi pour la ville.
À l’intérieur, les visiteurs sont impressionnés par les hauts plafonds, les vitraux modernes qui diffusent une lumière colorée, et les nombreuses chapelles ornées, offrant une atmosphère de sérénité propice à la réflexion. Ces vitraux racontent des histoires spirituelles et reflètent l’identité culturelle de la communauté locale.
- Musée de l’Hospice Comtesse
Situé dans un ancien hôpital médiéval, ce musée offre un aperçu fascinant de l’histoire et du patrimoine de Lille, avec des intérieurs magnifiquement préservés.
- Gare Saint Sauveur
Ancienne gare devenue centre culturel, la Gare Saint Sauveur accueille des expositions, des concerts et des événements familiaux, tandis que le quartier environnant est connu pour son beffroi art déco et son ambiance urbaine animée.
Elle propose une variété d’expositions d’art, de musique live et d’événements culturels, ce qui en fait une destination animée et engageante.

- Wazemmes District & Market
Wazemmes est célèbre pour son atmosphère multiculturelle et son marché dominical animé, offrant de tout, des produits frais aux trouvailles vintage – un favori local pour les gourmets et les chasseurs de bonnes affaires.



Le Marché de Wazemmes est l’un des plus grands et des plus emblématiques marchés de France, situé place de la Nouvelle Aventure dans le quartier populaire et cosmopolite de Wazemmes à Lille. Il se tient trois fois par semaine : mardi, jeudi et surtout le dimanche de 7h à 14h, ce dernier étant le plus animé, avec près de 400 commerçants et jusqu’à 50 000 visiteurs certains dimanches.
Le Marché de Wazemmes est donc un lieu incontournable pour découvrir l’authenticité, la diversité et la convivialité de Lille, que ce soit pour faire ses courses, flâner ou simplement profiter de l’ambiance unique du quartier
MUSEES
La région Hauts-de-France regorge de musées variés, allant des beaux-arts à l’histoire industrielle, qui témoignent de sa richesse culturelle et patrimoniale, particulièrement :
La Piscine - Musée d'art et d'industrie André Diligent de Roubaix (75 kms)
Installé dans une ancienne piscine art déco, ce musée propose une collection unique mêlant beaux-arts, arts appliqués et histoire industrielle, offrant une expérience culturelle originale et très appréciée des visiteurs.

Palais des Beaux Arts de Lille (70 kms)
L’un des plus grands musées de France, il se distingue par la richesse de ses collections, notamment en peinture flamande et européenne, et ses expositions temporaires de grande qualité.

Louvre-Lens Museum (30kms)
Ce musée satellite du Louvre à Paris propose une scénographie moderne et une sélection d’œuvres couvrant plusieurs millénaires, idéal pour les amateurs d’art et d’histoire dans un cadre architectural contemporain.
Ce musée satellite du Louvre à Paris propose une scénographie moderne et une sélection d’œuvres couvrant plusieurs millénaires, idéal pour les amateurs d’art et d’histoire dans un cadre architectural contemporain.

Musée de la Chartreuse de Douai (53 kms)
Ce musée d’art, installé dans un ancien monastère, se distingue par ses collections de peintures, sculptures et objets d’art, tout en offrant un cadre historique remarquable.

Musée de l'Hospice Comtesse Lille (72 kms)
Installé dans un ancien hospice médiéval, ce musée présente l’histoire de Lille à travers des collections d’art et d’objets historiques dans un cadre authentique et chargé d’histoire.

Musée Henri Matisse au Cateau-Cambrésis (110 kms)
Le musée Henri Matisse du Cateau-Cambrésis a rouvert ses portes le 22 novembre 2024, après une fermeture de 18 mois pour travaux d’extension et de rénovation. Le projet, piloté par l’architecte Bernard Desmoulin, a permis d’agrandir le musée de près de 1 000 m², offrant un nouveau visage à cet espace emblématique dédié à l’un des plus grands maîtres du XXe siècle, enfant du pays.

Musée d’Art Moderne Villeneuve d’Ascq (70 kms) Actuellement fermé pour rénovation
En raison d’une série de travaux menée par la Métropole Européenne de Lille et le LaM visant à rénover les bâtiments du musée, le musée est fermé depuis le 30 septembre 2024 et rouvrira en début d’année 2026.
Pendant sa fermeture, le LaM propose une programmation hors-les-murs riche et diversifiée qui s’étend sur la Métropole Européenne de Lille, les Hauts-de-France et au-delà, reflétant l’ensemble des activités du musée. Elle comprend des expositions dans des lieux tels que la Condition Publique de Roubaix, la Ferme d’en Haut, l’Espace Culture de l’Université de Lille, et la Bibliothèque Cœur de Bellain à Douai.
https://www.musee-lam.fr/fr/lam-vagabonde

